Noctilux
Ce terme, déposé par Leica, désigne un objectif d'ouverture maximale f/1,2, f/1 ou f/0,95. Plus précisément, cela signifie que l'objectif atteint le sommet (summit) de la performance pour les photographies avec peu de lumière (le noct venant de nocturne).
Elmar
Ce terme, déposé par Leica, désigne un objectif d'ouverture maximale f/3,5 (ou supérieur).
L'objectif 50 mm repliable pour Leica M, nommé "Elmar" constitue une exception car il ouvre à f/2,8. Il aurait dû s'appeler "Elmarit" mais a gardé le nom de l'Elmar original des années 1930, par nostalgie et pour des raisons de marketing (le 50 mm repliable f3,5 Elmar - fabriqué de 1930 à 1959 - étant un des objectifs les plus célèbre et populaire).
R9
Un R8 allégé et modernisé (2002-2009). Comme son prédécesseur, ce boîtier argentique peut être équipé du dos numérique DMR. Cf. cette page.
R8
Un Leica R ergonomique, pouvant être équipé du dos numérique DMR (1997-2002). Cf. cette page.
R6
Un reflex Leica avec un obturateur mécanique jusqu'au 1/1000e (1987-1992). Cf. cette page.
R6.2
Le dernier Leica R purement mécanique (1992-2002). Cf. cette page.
R4
La seconde génération (1980-1988) des reflex Leica R.
Cf. cette page
MP
Cf. http://www.summilux.net/m_system/mp2003.html pour le modèle sorti en 2003 ou http://www.summilux.net/m_system/mp.html pour le modèle sorti en 1956.
Leica M
Appareils télémétrique argentiques (24x36) et numériques (18x27 et 24x36). Pour voir l'ensemble des modèles, allez sur cette page.
Ce nom a aussi été donné à un appareil numérique sorti en 2012, sobrement nommé Leica M.
télémètre
Instrument de mise au point qui détermine la distance entre le sujet à photographier et l'appareil. La plupart des Leica sont munis d'un télémètre. Pour les Leica M, on parle de bloc viseur-télémètre car cet élément joue un double rôle : c'est à la fois un télémètre pour la mise au point de l'objectif, avec lequel il est couplé, et un viseur de haute qualité.

Photo © Jean-Pierre Dep (pièces constitutives du télémètre d'un Leica à vis)
Elmax
Dénomination provisoire de l'objectif Elmar, avant la commercialisation et pour les tous premiers modèles. Elle est formée des initiales Ernst Leitz, puis du prénom de Max Berek, ingénieur concepteur des optiques Leitz dans les années 1920 et 1930. Le 50 mm Elmax fut le premier objectif du Leica en 1924-1925. Certains ont été commercialisés avec la monture fixe du premier Leica de 1925.
Lire www.summilux.net/fixes/Elmax50.html.
Pradovit P150
Cf. http://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
Pradovit P300
Cf. http://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.
Pradovit P600
Cf. http://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.
Minilux
Compact argentique haut de gamme produit par Leica de 1995 à 2003. Vous trouverez tous les détails sur http://www.summilux.net/compacts/Minilux.html. Une version "Minilux Zoom" a aussi existé.
Minilux Zoom
Compact argentique haut de gamme produit par Leica de 1995 à 2003. Vous trouverez tous les détails sur http://www.summilux.net/compacts/MiniluxZoom.html. Une version "Minilux" avec un objectif à focale fixe a aussi existé.
CM
Compact argentique haut de gamme commercialisé par Leica à la fin 2003. Cf. http://www.summilux.net/compacts/LeicaCM.html.
CM Zoom
Compact argentique haut de gamme commercialisé par Leica en 2004. Cf. http://www.summilux.net/compacts/LeicaCMZoom.html.
FOOVA
Grande bobineuse Leitz (1939 et après-guerre), qui accepte jusqu'à 100 mètres de film
et permet de l’enrouler en plein jour dans les chargeurs Leitz.

GBOOM
Filtre jaune n° 0 en monture L, produit par Leitz en 1939.
KINSU
Viseur commercialisé par Leitz en 1934. Adapté aux caméras avec des objectifs de 1,5 , 2 , 2,5 , 3,5 , 7,5 , 10 et 15 cm.
Vario
Désigne les zooms parmi les objectifs Leica. On citera par exemple le Vario-Apo-Elmarit-R 70-180 mm.
YBEOO
Filtre jaune n°0 en monture E43, commercialisé par Leitz en 1959.
Jumelle
Instrument d'observation binoculaire. Leica commercialise de nombreux modèles. On citera la gamme Ultravid qui est composée d'excellents modèles allant du 8x20 au 12x50.
Leicavit
Dispositif d'armement rapide se substituant à la semelle de certains Leica, actionné par le majeur de la main gauche.
Trois modèles, les couples (codes Leitz à 5 lettres / n° de référence) sont indiqués entre parenthèses :
1) Leicavit pour Leica à vis des séries c (à partir du n° 400001), f et g (SYOOM / 14009),
2) Leicavit MP pour Leica MP (originel), M1, M2, et MD (SMYOM / 14008),
3) Leicavit M pour Leica M4-2, M4-P, MD-2, M6, M7 et le nouveau Leica MP (14009 laqué noir, 14450 chromé noir, 14008 chromé argent).
Armvit
Dispositif d'armement rapide se substituant à la semelle de la plupart des Leica antérieurs au IIIc, actionné par l'index de la main gauche ; une version existe pour le Leica IIIc (jusqu'au n° 397607).
Code Leitz à 5 lettres : SCNOO.
Focotar
Objectif d'agrandissement équipant les agrandisseurs Leitz (deux modèles : Focotar f:4,5/50 mm et Focotar f:4,5/60 mm).
SBLOO
SBLOO/12010 (code Leitz à 5 lettres, puis référence numérique) Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 3,5 cm (35 mm).
Existe en deux versions, se différenciant par le sabot de fixation et le logo gravé sur le dessus. Ci-dessous la première version :

Photos JFK
SBOOI
SBOOI/12015 (code Leitz à 5 lettres, puis référence numérique)
Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 50 mm.
Face avant :

Photo © Philippe D.
Le grandissement est x1 : l'image de visée paraît grandeur nature (on peut conserver les deux yeux ouverts),
dans un cadre collimaté argenté comportant une ligne tiretée destinée à corriger la parallaxe.
Existe en plusieurs versions, se différenciant par le graphisme des inscriptions gravées sur le périmètre antérieur,
par la mention "5 cm" ou "50 mm" et par l'absence ou la présence de stries guillochées latérales antidérapantes.

Photo © La Grinche
SHOOC
Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 135 mm (code Leitz à 5 lettres).


Photos © Fanfan D.


Photos © Leonid
SGVOO
SGVOO/12025 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 9 cm, soit 90 mm ; à la base, un patin rotatif gradué en fonction de la distance permet de compenser la parallaxe.

Photo © engelfangen
SLOOZ
Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 28 mm (code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 12007).
Ci-dessous la dernière version de ce viseur, en finition noire avec son étui en cuir :


Photos © rodolph M
SBKOO
Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 21 mm (code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 12002).
Ci-dessous la dernière version de ce viseur, en finition noire avec son étui en cuir :


Photos © rodolph M
SFTOO
Viseur annexe "tubulaire" à cadre procurant le champ de la focale 200 mm (code Leitz à 5 lettres ; également références n° 12034 et 12035).
SQTOO
Viseur annexe "tubulaire" procurant le champ de la focale 400 mm (code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 12037).
VOORF
VOORF/16508 est un adaptateur destiné à monter la tête optique du Summicron f:2/5 cm (deuxième version, dite "rigide") sur le dispositif SOMKY (voir cette référence).
Apparemment, l'ancienne référence UOORF est synonyme de VOORF.
Bokeh
Le bokeh (ou bo-ke) est une notion plutôt abstraite et assez ardue... Ce terme est utilisé, principalement par les auteurs de langue anglaise, pour qualifier l'impression ressentie en observant l'ensemble des innombrables "points" d'une image qui ne sont pas "au point" ; chacun est en réalité un disque, correspondant à la section d'un cône de lumière formé par l'objectif à partir d'un objet ponctuel (la frontière du disque est nommée "cercle de confusion", c'est la limite à l'intérieur de laquelle l'image du point est "confuse"). Ainsi, le bokeh définit l'aspect d'une image en dehors de la zone de profondeur de champ, c'est-à-dire la "qualité du flou" de cette image (voir un exemple tout en bas).
En raison de l'aberration sphérique résiduelle de l'objectif ("défaut" dont aucun ne peut être totalement dépourvu), chaque disque n'est pas éclairé de façon uniforme ; ces modes d'éclairement sont variables, selon le degré de correction de cette aberration. Un bokeh théoriquement idéal nécessite que la luminosité du cercle de confusion soit répartie selon une courbe de Gauss, décroissant depuis le centre pour se perdre vers la périphérie (figure de gauche) ; tout se passe comme si l'ensemble des disques se fondaient harmonieusement, le flou est progressif et "doux" : le bokeh est estimé beau. Dans le cas contraire (périphérie plus lumineuse que le centre, frontière du disque tranchée : figure de droite), l'aspect de l'image en dehors de la zone de profondeur de champ peut présenter une certaine "structure", qui s'explique par des interférences entre cercles : le bokeh est jugé peu séduisant. Enfin, chez certains objectifs, un phénomène complexe fait que le bokeh peut conférer à l'image une impression de profondeur (effet "3D").
Ces figures illustrent un disque correspondant à la section d'un cône de lumière, selon les deux caractères de bokeh envisagés ci-dessus :

Contrairement à une idée reçue, le nombre de lamelles du diahragme d'un objectif joue un rôle négligeable dans le bokeh : si, par le contour de son ouverture, le diaphragme détermine la "circularité" du cercle de confusion, il ne répartit pas la luminosité du disque que ce cercle circonscrit.
Un peu d'étymologie, pour terminer. Certains estiment que le terme bokeh proviendrait du japonais  ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...
ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...

(photo Laurent A)
contacts 6 bits
Système de code d'identification d'une optique M, mis en place par Leica en 2006 à l'occasion de la sortie du premier M numérique. Pour en savoir plus, consultez cette page.
Leica 0
Cf. www.summilux.net/avis/Leica0.html.
Leica '0'
Cf. www.summilux.net/avis/Leica0.html.
focale
Voir distance focale.
Ultravid
Gamme de jumelles Leica, allant du 8x20 au 12x50.

Leica R9
Un R8 allégé et modernisé (2002-2009). Comme son prédécesseur, ce boîtier argentique peut être équipé du dos numérique DMR. Cf. cette page.
paralaxe
Ce mot n'existe pas, essayez parallaxe.
parallaxe
Voir correction de parallaxe.
WINTU
Viseur d’angle se fixant dans la griffe porte accessoire, permettant de cadrer "discrètement" à angle droit avec un Leica à vis ; l’image est inversée latéralement. Un prisme sur bras articulé permet d’utiliser le télémètre. Cet accessoire est apparu en 1933. Finition : chromé ou laqué noir.




Photos © Yann T


Photos © Gil_78-2B
APDOO
APDOO/14003 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Retardateur pneumatique à visser à la place de la collerette du déclencheur. Commercialisé par Leitz de 1938 à 1965.
La version la plus récente, datant d'après guerre permet de mettre en place directement le retardateur sans pour autant devoir dévisser la collerette du boîtier (à partir du Leica IIIc) en évitant de ce fait, la perte de celle-ci.
A noter que l'étui en cuir accompagnant le retardateur porte le code APOOM.
L'ensemble retardateur et étui en cuir est référencé sous le code à cinq lettres ASKOO.

Photo © Jean-Pierre Dep
OKARO
OKARO/14058 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Petit filtre orange à emboîter sur l’un des deux verres antérieurs du télémètre pour en augmenter le contraste.
Destiné aux modèles Leica IIIb, IIc, IIIc, IIf et IIIf. Commercialisé par Leitz à partir de 1939, chromé.
ORAKO
ORAKO/14057 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Petit filtre orange à emboîter sur l’un des deux verres antérieurs du télémètre pour en augmenter le contraste.
Destiné aux modèles Leica II, III, IIIa et également au télémètre FOKOS.
Commercialisé par Leitz à partir de 1936, noir ou chromé.
XOOIM
Pare-soleil conique pour Summilux f:1.4/50mm première version; ; la fixation s’effectue par 4 griffes à ressort situées dans la bague adaptatrice.
XOONS
XOONS/12520 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Pare-soleil de forme octogonale aux côtés plans destiné au Summarit f:1,5/5 cm ; un ajour situé en face interne permet la visée. La fixation s’effectue par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis. Peinture noire en finition "craquelée".

Photo © Philippe D.
NOOKY
Accessoire de type bague-allonge permettant la photo rapprochée avec un Leica à vis (sauf IIIg) ; la compensation de la parallaxe est assurée. Rapport : 1:6 à 1:17,5 (sauf troisième cas ci-dessous).
Existe en trois versions pour différents objectifs de distance focale 5 cm :
NOOKY / 16500 pour Elmar
NOOKY-HESUM pour Hektor, Summar et Summitar
SOOKY / 16502 pour Summicron (rapport : 1:8 à 1:17,5)

Photo © Philippe D.

Photo © floguill


Photos © Mimo

Photo © telemetrix
CEYOO
Flash magnésique à réflecteur dépliable en éventail. Commercialisé par Leitz de 1950 à 1959.

Ce flash est associé à un Leica IIIf par l’intermédiaire de l’embase CTOOM/15545.
CTOOM
CTOOM/15545 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Embase métallique permettant d’associer un boîtier Leica M3 ou M2 à un flash, munie d’un bras métallique orientable à 180°. Peinture noire en finition "craquelée". Commercialisé par Leitz de 1953 à 1964.

Existe en version plastique de couleur crème pour le flash CHICO de même matière :

Photos © Philippe D.
OOBAZ
OOBAZ/16607 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Ce dispositif de reproduction à glissière pour Leica à vis, datant de 1958, a succédé à un système analogue apparu vingt ans plus tôt (OOZAB) ; il est destiné à être monté sur un statif. Le cadrage et la mise au point s’effectuent sur un verre finement dépoli, à travers une loupe droite ou à visée redressée, puis la glissière est manœuvrée et le boîtier se substitue dans l’axe optique pour la prise de vue.
OOTGU
OOTGU/16680 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Dispositif de reproduction à glissière pour Leica "M" apparu en 1957, similaire à OOBAZ.
FIKUS
FIKUS/12530 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Pare-soleil cylindrique extensible pour objectifs de distance focale 3,5 à 13,5 cm (soit 35 à 135 mm) en monture A36 (au catalogue Leitz de 1933 à 1965) ; la fixation s’effectue par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis.

Photo © Michel (proteus)
SOOBK
SOOBK/12500 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Pare-soleil pyramido-rectangulaire pour Summaron f:5,6/2,8 cm ; la fixation s’effectue par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis. Peinture noire en finition "craquelée".
ITDOO
(code Leitz à cinq lettres)
Pare-soleil conique pour objectifs Summaron f:3,5/3,5 cm (convient aussi au f:2,8) et Summicron f:2/5 cm en monture E39, apparu en1956 ; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés.
Base chromée, cône métallique noir.

L'ITDOO est le pare-soleil de gauche (l'autre est un IROOA/12571).
IROOA
IROOA/12571 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Pare-soleil conique pour objectifs de distance focale 35 et 50 mm en monture (pour filtres) E39, apparu en 1959 ; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés. Base chromée, cône métallique noir.

L'IROOA/12571 est le pare-soleil de droite (l'autre est un ITDOO). Photos Philippe D. (ci-dessus) et bulb (ci-dessous).


ITOOY
ITOOY/12580 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Pare-soleil cylindrique pour Elmar f:3,5/5 cm et f:2,8/50 mm en monture E39, apparu en 1956 ; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés.


IUFOO
IUFOO/12575 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Pare-soleil cylindro-conique pour objectifs de distance focale 90 et 135 mm en monture E39, apparu en 1956; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés.

La référence 12575 a été reprise pour le pare-soleil destiné au Macro-Elmar-M 90 mm f/4
FISON
FISON/12510 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Pare-soleil cylindrique pour Elmar f:3,5/5 cm en monture A36 (au catalogue Leitz de 1925 à 1963) ; d’abord à emboîtement, la fixation s’effectue à partir de 1935 par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis.
FOOKH
FOOKH/12505 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Pare-soleil cylindrique chromé pour Elmar et Summaron f:3,5/3,5 cm, apparu en 1951 ; la fixation s’effectue par serrage d’un collier au moyen d’une petite vis.
Champignon
Infestation mycélienne d'une optique
Voici le fruit des investigations autour d'un objectif "Jupiter" : nous avons examiné cette lentille et les champignons qui commençaient à l’envahir…
1) Caractéristiques de la lentille
La lentille frontale du Jupiter f:2/50 mm est un ménisque convergent de 29 millimètres de diamètre et de 50 millimètres de distance focale ; la face convexe du ménisque est orientée vers l’avant ; sa tranche est cylindrique, haute d’environ un millimètre, dépolie (non peinte en noir). Cette lentille frontale correspond à l’équivalent sur le schéma ci-dessous :
............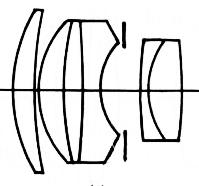
Coupe du Sonnar f:2/5 cm (six éléments en trois groupes), 1931.
En raison de sa distance focale égale à celle de l’objectif lui-même, la lentille frontale semble suffire à former l’image ; le rôle des deux groupes arrières (triplet et doublet) est probablement de corriger les aberrations et d’atténuer le vignettage.
2) Moyens d’observation
Après un examen à l’aide d’une forte loupe, nous avons utilisé deux instruments :
- loupe binoculaire Leica MZ 75,
- microscope Nikon Eclipse 80i (objectifs Plan 4x/0,10 et Plan Fluor 40x/0,75).
La loupe binoculaire  offre un champ plus large que le microscope, qui permet des observations plus détaillées.
offre un champ plus large que le microscope, qui permet des observations plus détaillées.
Dans les deux cas, l’examen a porté sur la face concave de la lentille, orientée vers le haut.
Eclairage : nous avons utilisé la lumière réfléchie et la lumière transmise, séparément ou conjointement (éclairage combiné).- lumière réfléchie : une source de lumière froide Zeiss KL 1500 LCD convoyant la lumière par deux fibres optiques.
- lumière transmise : éclairage normal du microscope.
En dirigeant convenablement les fibres optiques, la lumière réfléchie crée des couleurs mettant bien en évidence les structures observées ; ces couleurs résultent probablement de la polarisation induite par la réflexion totale sur le dioptre inférieur, c’est-à-dire sur l’intérieur de la face convexe de la lentille (face orientée vers le bas).
Les conditions requises en microscopie n’étaient pas réunies, pour les quatre raisons suivantes :- observation à sec (c’est-à-dire dans l’air) contrairement à une préparation microscopique conventionnelle,
- non-planéité du champ d’observation (concavité de la lentille),
- hauteur de ce champ trop importante par rapport au condenseur,
- milieu inférieur non à faces parallèles (la lumière transmise traversant le ménisque).
Les observations furent néanmoins satisfaisantes, à la suite de divers réglages.
Les photos ont été prises de la façon suivante, selon l’instrument utilisé :- loupe binoculaire : appareil Canon EOS 550D équipé d’un Summicron-R f:2/90 mm, aligné dans l’axe optique de l’un des deux oculaires.
- microscope : appareil Nikon D300 monté à demeure dans l’axe optique.
3) Les observations
Localisation et aspect du mycélium
L’infestation mycélienne de cette lentille frontale s’avère assez limitée ; elle paraît avoir été plus importante sur la face externe (convexe), qui avait été nettoyée (nous avons constaté la présence d’un feutrage résiduel en périphérie).
Nous avons observé de nombreux hyphes (filaments mycéliens) sur le pourtour de tout le périmètre de la face interne (concave) ; ces hyphes sont épars ou clairement organisés en "buissons" ramifiés dressés perpendiculairement au périmètre, étroitement plaqués contre le verre ; ces ramifications à partir d’un centre germinatif correspondent au mode de propagation classique du mycélium. Nous n’avons pas observé l’appareil reproducteur permettant la multiplication asexuée par spores, dites conidiospores ou conidies.
Nous nous sommes particulièrement intéressés à deux "buissons" voisins, mesurant respectivement 0,9 et 4,3 millimètres de hauteur, ce dernier étant le plus important de toute la face (il s’agit de l’arborescence remarquée initialement, discernable ici) ; nous avons photographié ces "buissons" dans différentes conditions.
Les hyphes cheminent de façon rectiligne ou sinueuse, certains progressent parallèlement sur une longue distance ; on observe entre eux des confluences et quelques "boucles".
La lumière réfléchie met en évidence un abondant exsudat bleuâtre de part et d’autre de chaque hyphe (teinte due à la polarisation de la lumière ?) ; il s'agit de métabolites excrétés (probablement des polysaccharides) destinés à protéger le mycélium de la dessiccation, selon Joëlle Dupont, une spécialiste consultée que nous remercions. Cet exsudat n’apparaît pas en lumière transmise.
Les photos !
Abréviations :
A = extérieur de la lentille (dont on voit un arc de périmètre), apparaissant diversement selon l’éclairage utilisé.
B = tranche de la lentille, vue par transparence en raison de la légère inclinaison adoptée.
Photos n° 1 et 2 (loupe binoculaire, lumière réfléchie) – Vues d’ensemble montrant les deux "buissons", selon deux orientations perpendiculaires et deux éclairages différents. La lentille est encore en place dans sa monture (marquée "bague").
1
2
Photo n° 3 (microscope, objectif 4x, éclairage combiné) – Même vue d’ensemble que la photo n° 1, montrant les deux "buissons". Montage de deux photos réalisées selon deux éclairages différents ; en raison du champ couvert, seule la partie inférieure du "grand buisson" a été photographiée. A ce niveau de grossissement, le périmètre de la lentille s’avère assez ébréché et montre de nombreuses entailles dues à l'usinage, orientées à 45°.
3
Photo n° 4 (microscope, objectif 4x, éclairage combiné) – L’une des deux photos du montage ci-dessus, illustrant la partie inférieure du "grand buisson". L’éclairage en lumière réfléchie met bien en évidence l’exsudat (substance excrétée par les hyphes), qui apparaît bleuâtre.
Les stries résiduelles du polissage croisé (à 45°) de la lentille sont perceptibles sur le verre.
4
Photos n° 5 et 6 (microscope, objectif 4x, n° 5 en éclairage combiné et n° 6 en lumière transmise) – Partie inférieure du "grand buisson", orientée perpendiculairement. Deux mises au point ont été réalisées pour tenir compte de la concavité de la lentille, ensuite fusionnées. On voit bien les ramifications des hyphes, leurs confluences et leurs "boucles". L’exsudat n’apparaît pas sur la photo n° 6.
L’échelle d'une lame micrométrique ajoutée à droite de la photo n° 6, photographiée avec le même objectif, mesure un millimètre (divisé en cent centièmes) ; elle permet d’évaluer la dimension de l’objet observé, et a servi de référence pour tracer les barres d’échelle ajoutées aux autres photos.
5
6
Photo n° 7 (microscope, objectif 40x, lumière transmise) – Vue à fort grossissement d’une petite partie du "grand buisson", montrant deux "boucles" (qui peuvent être repérées notamment près du centre la photo n° 4, orientée différemment) ; la structure répétitive le long des hyphes représente probablement le contenu cellulaire ; la largeur d’un hyphe est d’environ 2 micromètres (la barre d’échelle mesure 50 micromètres).
7
Photo n° 8 (microscope, objectif 4x, éclairage combiné) – détail de la partie sommitale du "grand buisson" : les terminaisons d’un hyphe ramifié.
8 
Photos n° 9 et 10 (microscope, objectif 4x, éclairage combiné) – Le "petit buisson". L’exsudat s’étend sur une surface proportionnellement importante ; la migration des molécules a suivi les stries résiduelles du polissage croisé de la lentille : les micro-gouttelettes sont alignées selon deux directions croisées à 45°.
9 
Photo n° 10 – recadrage de la photo précédente ; le traitement appliqué à cette image matérialise bien les stries résiduelles du polissage, croisées à 45°.
10 
4) Nutrition du mycélium
Les champignons ne sont plus classés parmi les végétaux depuis plus de trente ans, mais constituent un règne à part entière nommé Mycètes ou Funji… Quoi qu’il en soit il s’agit d’êtres vivants, qui n’assurent pas leur métabolisme en puisant dans l’air du temps ou – dans le cas présent – en grignotant le verre ! Le développement de mycélium dans certains objectifs photographiques est un sujet souvent évoqué et parfois associé à des croyances erronées ; cette contamination malencontreuse suit simplement les lois de la nature…
La germination de la conidiospore initiale (ou des conidiospores initiales) dans cet objectif ne se serait pas produite si un milieu nourricier n'avait pas existé, en présence d'une humidité indispensable. Le mycélium que nous avons observé s’est donc propagé à partir d'un centre germinatif, qui est aussi un milieu nourricier : graisse ou huile lubrifiant le mécanisme de l’objectif (rampe hélicoïdale de mise au point, lamelles du diaphragme) ; aucune autre origine nutritive n’est envisageable dans un objet technologique fait de métal et de verre. A la surface de la lentille elle-même, sur laquelle il a progressé en se ramifiant, le mycélium ne trouva plus d'éléments nutritifs, aussi sa croissance a fini par s'arrêter (photo n° 8) ; elle a pu également cesser si le milieu ambiant a perdu son humidité.
5) La corrosion du verre par le mycélium
L’infestation mycélienne peut, dans certains cas, endommager les surfaces optiques d’appareils photographiques ou de microscopes (entre autres instruments), notamment dans les régions tropicales humides. On le constate en examinant le verre après nettoyage complet : il ne présente plus la même transparence, ni la même brillance, et paraît localement trouble c’est-à-dire finement dépoli. Une telle corrosion paraît étonnante, en raison de la résistance présumée du verre à la plupart des acides… mais en l’occurrence il ne s’agit pas de verre borosilicaté (Pyrex par exemple) qui serait presque inaltérable : le verre optique, dont la composition – d’ailleurs variée - est très différente, demeure au contraire susceptible d’être attaqué par quelques agents chimiques, d’autant plus s’il est ancien. La biologie des Mycètes ne cesse d’étonner ; leurs hyphes secrètent diverses substances, certaines – de toute évidence corrosives pour les silicates – pouvant en effet attaquer superficiellement le verre.
Victor Bellaich a eu l’amabilité de nous montrer l’objectif de visée (Heidosmat f:2,8/80 mm) de son Rolleiflex, qu’il avait nettoyé après une infestation mycélienne : une petite partie de la surface de l’une des lentilles est devenue dépolie. D’autre part, Victor a restauré un Leica M3 gravement endommagé par une longue exposition à l’humidité : on remarquera ci-dessous les nombreuses traces, sinueuses et verdâtres, laissées par du mycélium sur la face avant de l’élément antérieur du viseur (doublet légèrement divergent), encore bien visibles en dépit d'un méticuleux nettoyage... Victor a confié cet élément à Marc Nicolas qui a effectué un polissage et le viseur a retrouvé sa transparence.
11 
Photo © Victor Bellaich, prise après nettoyage et avant polissage (merci Victor ! :wink: ).
6) Epilogue
La composition des graisses et huiles lubrifiant le mécanisme des objectifs photographiques modernes est probablement différente de celles des objectifs anciens : antifongique comme l’envisage Bertrand sur le forum, ou exempte d'éléments nutritifs ? Mais les graisses et huiles modernes sont des composés organiques dérivés du pétrole, ce qui était vraisemblablement le cas de leurs homologues voici un demi-siècle... Quoi qu’il en soit, une précaution essentielle et évidente est de ne pas entreposer le matériel optique dans un lieu humide.
Jean D. et Gilles T
VOOLA
VOOLA/16621 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Bague se plaçant sur la couronne de l’Elmar f:3,5/5 cm, coiffé d’un filtre A36 ou du pare-soleil FISON, permettant la rotation du "doigt" de réglage du diaphragme en faisant pivoter ce filtre ou ce pare-soleil (cette bague est apparue en 1955).

© Gianni Rogliatti (1977)

Photo © mcintosh
TSOOV
TSOOV/14092 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Courroie de cou en cuir noir, réglable en longueur et terminée par deux anneaux brisés, apparue en 1960 (ultérieurement livrée avec une épaulière), destinée à porter le Leica par ses oeillets.

TOOUG
TOOUG/14100 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Trépied de table repliable apparu en 1952, peinture noire "caquelée" puis grise émaillée (sans la rotule).
 |
Ce trépied existe toujours au catalogue Leica sous la référence 14100, bien que le design ait été modifié en 1971. Voir les pages consacrées aux accessoires R ou M. |
Code Leitz à cinq lettres
Référence des produits Leitz, sous forme de cinq lettres majuscules. On parle de "code télégraphique" ("Telegrammwort" en allemand).
En effet, à l'épode on utilisait le télégramme comme mode de communication rapide. Ce n'est qu'aux environs de 1946 que le Telex le remplaça peu à peu, en particulier pour les communications commerciales.
Le code alpha de Leitz à 5 lettres était motivé par le fait que le coût des télégrammes était calculé au nombre de mots. D'où ce système pour faciliter la communication, et en abaisser son coût.
Dans son livre Leica - A History ..., Paul-Henry van Hasbroeck précise que ce code télégraphique est apparu pour la première fois en Mai 1925 dans le catalogue de l'agent Leitz britanique Ogilvy & Co.
Les codes à chiffres sont apparus en 1939, mais ne furent utilisés systématiquement qu'à partir de 1960.
Exemple : TOOUG
référence
Code d'un produit Leica.
Exemple : 14100.
MBROO
Housse en aluminium, étanche, pour les Leica IIIc et IIIf coiffés d'un objectif rentrant.
Résistante aux chocs, aux embruns de la mer et au sable du désert !
Commercialisée de 1954 à 1961.

MOOLY
Moteur mécanique à ressort pour Leica III dont le numéro est supérieur à 159 000.
Les boîtiers aux numéros inférieurs nécessitaient une transformation préalable.
Apparu en 1938, ce moteur permet la prise de photos individuelles successives, et aussi d'une série de douze images consécutives en six secondes (le ressort ayant préalablement été complètement remonté).
Le Leica IIIc, dont le boîtier est plus long de 2,8 mm, nécessita un nouveau moteur paru sous le code MOOLY-C.

HEBOO
Dispositif permettant de disposer de quatre vitesses lentes (1/8ème, ¼, ½ et 1 seconde), destiné aux modèles de Leica à vis en étant dépourvus ; se visse sur le filetage entourant le déclencheur, à la place de la collerette.
Cet accessoire, apparu en 1934, existe en deux finitions : laqué noir et chromé.


Deuxième photo : © Gil_78-2B
FHKOO
"Porte-film pour une vue" (apparu en 1936) qui, chargé d’un morceau de film de longueur largement supérieure, peut être introduit dans un boîtier Leica (modèles jusqu’au IIIb). le FHKOO peut être considéré comme une variante rudimentaire (mais équivalente) de l’OLIGO (codes Leitz à cinq lettres).

FCKOO
"Porte-film pour une vue" (apparu en 1951) qui, chargé d’un morceau de film de longueur largement supérieure, peut être introduit dans un boîtier Leica (modèles du IIIc au IIIf mais dans ce dernier cas à semelle dépourvue de patte d’alignement du film). Le FCKOO succède au FHKOO ; ces deux accessoires peuvent être considérés comme une variante rudimentaire (mais équivalente) de l’OLIGO (codes Leitz à cinq lettres).

Summarit
Le nom "Summarit" dérive du latin "summum", ayant donné en français le mot "sommet" (allusion à l'excellence de l'optique).
Nom donné à plusieurs objectifs d'ouvertures différentes :
- f:1,5 avec les Summarit 5 cm à vis (1949-1960) et Summarit 5 cm en monture M (1954-1960)
- f:2,4 avec le 40 mm intégré aux compacts Leica Minilux et CM (1995-2007) ou avec la gamme des Summarit-M Asph. annoncés en 2014 (sortis en 2015)
- f:2,5 avec la gamme des Summarit-M présentée en 2007 et les Summarit-S annoncées en 2008
OUBIO
La bague OUBIO/16466 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique) permet de monter sur les chambres Visoflex II et III les objectifs suivants :
Hektor f:2,5/12,5 cm
Hektor f:4,5/13,5 cm (en monture courte)
Elmar f:4,5/13,5 cm (en monture courte)
Elmar f:4/135 mm (en monture courte)
Telyt f:4,5/20 cm
Telyt f:4/200 mm
Telyt f:4,8/280 mm
Telyt f:5/40 cm
Cette bague possède un pas de vis permettant de la fixer sur un trépied.
16466
La bague OUBIO/16466 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique) permet de monter sur les chambres Visoflex II et III les objectifs suivants :
Hektor f:2,5/12,5 cm
Hektor f:4,5/13,5 cm (en monture courte)
Elmar f:4,5/13,5 cm (en monture courte)
Elmar f:4/135 mm (en monture courte)
Telyt f:4,5/20 cm
Telyt f:4/200 mm
Telyt f:4,8/280 mm
Telyt f:5/40 cm
Cette bague possède un pas de vis permettant de la fixer sur un trépied.
FODIS
Télémètre introduit en 1923 (code utilisé pour l'ensemble télémètre FODUA + étui en cuir EUVER)


Photos © Gérard Métrot
FOKAL
Accessoire de montage pour le télémètre FOKIN (1930).
FOKOS
Télémètre pour Leica Standard (base de 7,5 cm). Produit entre 1933 et 1945, dans différentes finitions.
Le même code désigne un télémètre chromé produit entre 1949 et 1966 (base de 6,5 cm).

Photo © Victor Bellaich

Photo © josmart
VISET
Viseur avec les cadres pour les objectifs de 3,5, 5, 9 et 13,5 cm (1932).





Photos © joel
VIDEO
Viseur avec des cadres pour des objectifs de 3,5, 5, 7,3 et 10,5 cm (1932).
VITRE
Viseur avec des cadres pour des objectifs de 3,5, 5 et 10,5 cm; ajustement de parallaxe (1932).
VIDOM
Viseur universel convenant aux objectifs des distances focales suivantes :
3,5 cm / 5 cm / 7,3 cm / 9 cm / 10,5 cm / 13,5 cm
Compensation de parallaxe
Disponible de 1933 à 1939
La vision est inversée droite-gauche ; son successeur VIOOH possède un double prisme redressant la vision.

Photo © Vincent D


Photos © Jean-Pierre Dep
TUVOO
Adaptateur 2,8 cm pour le viseur VIOOH
(équivalent en référence numérique : 12005)
Voici le profil droit d’un viseur universel VIOOH sur lequel est vissé le cône TUVOO :

Photo déjà publiée ici.
OLLUX
Pare-soleil spécifique de la première version du Summilux f:1,4/35 mm (apparue en 1961),
jusqu'au numéro 2166700, dont le diamètre externe de la couronne antérieure est de 46,5 mm.
(référence numérique : 12522)
DOOLU
Niveau à bulle circulaire (similaire au FIBLA), se fixe dans la griffe porte-accessoires du boîtier
ou du support panorama FIAVI. Apparu en 1936. DOOLU-CHROM pour la version chromée.

Photo © Gil_78-2B
OTZFO
Bague ultérieurement référencée 16464 (= 16464 K), permettant de monter sur les chambres Visoflex II et III les quatre objectifs suivants :
- Elmar f:3,5/65 mm
- tête optique de l’Elmarit f:2,8/90 mm
- tête optique de l’Hektor f:4,5/135 mm
- tête optique du Tele-Elmar f:4/135 mm
Dans ces deux derniers cas, intercaler la bague OTSRO/16472.
Voir ici (page 13) et là (page 4).
FILCA
Chargeur de film destiné au Leica à vis, ouvert et fermé par la rotation de la clé de la semelle.

Photo © Georges Vaussy
IXMOO
Chargeur de film, dit aussi "modèle N", destiné à tout modèle de Leica (à vis et "M" jusqu'au M6 mais pas au M5),
ouvert et fermé par la clé de la semelle. Nouvelle référence : n° 14006.

Photo © macinside
A gauche : emballage cartonné.
Au centre : la boîte (référence n° 14010).
A droite : les deux parties coulissantes du chargeur.
En bas : la bobine (référence n° 14015).
DRXOO
Boîte en aluminium du chargeur FILCA ; nouvelle référence : n° 14010.

Photo Georges Vaussy
OZXVO
Système déclencheur à câble unique permettant de coupler un boîtier Leica à vis avec une chambre Visoflex I.
Référence numérique : 16493

Une version existe pour boîtier "M" : OZXVO-M

SOMKY
Le dispositif pour mise au point rapprochée à compensation de parallaxe ("lunettes") SOOKY-M (ensuite nommé SOMKY/16507) peut recevoir* l’Elmar f:3,5/5 cm, l’Elmar f:2,8/50 mm et la première version du Summicron f:2/5 cm ; le rapport de reproduction s'étend de 1/7,5 à 1/15 (gamme de mise au point s'étendant de 48 à 88 cm).
* par la baïonnette arrière à trois ailettes de la tête optique, c'est-à-dire que l'objectif est en position "rentré".
La bague UOORF/16508 permet de monter sur le dispositif SOMKY/16507 la tête optique dévissable de la deuxième version du Summicron f:2/5 cm.

Photo © Philippe D.
à gauche : tête optique du Summicron f:2/5cm (deuxième version)
en haut : son fût
en bas à gauche : bague adaptatrice UOORF/16508
en bas au centre : dispositif SOMKY/16507
Leicameter
Posemètre fabriqué par Metrawatt en association avec Leitz, se glissant dans la griffe porte-accessoires et s’accouplant au barillet des vitesses d’un boîtier Leica "M" (jusqu’au Leica M4-P).
Ci-dessous, près d’un Leica M3, voici le premier des quatre modèles successifs : le Leicameter-M, fonctionnant au sélénium, illustré avec le volet relevé pour utilisation en lumière faible (code Leitz à cinq lettres : METRA).

Photo © Aymeric
Ci-dessous, voici un Leicameter-MC (fonctionnant également au sélénium) possédant deux échelles de mesures, avec son volet opalescent pour lumière incidente et son amplificateur ("booster") destiné à amplifier quatre fois la quantité de lumière reçue en cas de lumière faible, celui-ci étant couvert par son volet opalescent.
(code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique : METRA/14200)



Photos © bulb
Ci-dessous, voici le dernier des quatre modèles successifs : le Leicameter-MR (dit MR-4), dont l’élément photosensible est au sulfure de cadmium.




Photos © bulb
METRA
Leicameter-M (code Leitz à cinq lettres : METRA)
Posemètre photosensible au sélénium apparu en 1955, destiné au Leica M3, se glissant dans la griffe porte-accessoires et s’accouplant au barillet des vitesses (ancienne norme, avant le n° 854001). Deux gammes de sensibilité selon la position du volet (percé d’une fente). Un élément enfichable existe, destiné à amplifier quatre fois la quantité de lumière reçue ("booster", code : MBOOW).
Un autre modèle photosensible au sélénium est apparu en 1957, le Leicameter-MC, s’accouplant au barillet des vitesses d’un boîtier Leica "M" (jusqu’au Leica M4-P), possédant deux échelles de mesures (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique : METRA/14200).
Voir ici dans les deux cas.
OUAGO
La bague OUAGO/16467 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique) permet de monter la tête optique d'un Elmar 9cm F/4 sur les chambres Visoflex II et III.
Une bague OTQNO/16468 supplémentaire s'intercale pour la photographie macro

SOOKY
Accessoire de type bague-allonge (dérivé du NOOKY/16500) permettant la photo rapprochée avec un Leica à vis (sauf IIIg) et la première version du Summicron f:2/5 cm (c’est-à-dire le Summicron rentrant) ; la compensation de la parallaxe est assurée. Rapport : 1:8 à 1:17,5. Référence équivalente : 16502.
Bokeh)
Le bokeh (ou bo-ke) est une notion plutôt abstraite et assez ardue... Ce terme est utilisé, principalement par les auteurs de langue anglaise, pour qualifier l'impression ressentie en observant l'ensemble des innombrables "points" d'une image qui ne sont pas "au point" ; chacun est en réalité un disque, correspondant à la section d'un cône de lumière formé par l'objectif à partir d'un objet ponctuel (la frontière du disque est nommée "cercle de confusion", c'est la limite à l'intérieur de laquelle l'image du point est "confuse"). Ainsi, le bokeh définit l'aspect d'une image en dehors de la zone de profondeur de champ, c'est-à-dire la "qualité du flou" de cette image (voir un exemple tout en bas).
En raison de l'aberration sphérique résiduelle de l'objectif ("défaut" dont aucun ne peut être totalement dépourvu), chaque disque n'est pas éclairé de façon uniforme ; ces modes d'éclairement sont variables, selon le degré de correction de cette aberration. Un bokeh théoriquement idéal nécessite que la luminosité du cercle de confusion soit répartie selon une courbe de Gauss, décroissant depuis le centre pour se perdre vers la périphérie (figure de gauche) ; tout se passe comme si l'ensemble des disques se fondaient harmonieusement, le flou est progressif et "doux" : le bokeh est estimé beau. Dans le cas contraire (périphérie plus lumineuse que le centre, frontière du disque tranchée : figure de droite), l'aspect de l'image en dehors de la zone de profondeur de champ peut présenter une certaine "structure", qui s'explique par des interférences entre cercles : le bokeh est jugé peu séduisant. Enfin, chez certains objectifs, un phénomène complexe fait que le bokeh peut conférer à l'image une impression de profondeur (effet "3D").
Ces figures illustrent un disque correspondant à la section d'un cône de lumière, selon les deux caractères de bokeh envisagés ci-dessus :

Contrairement à une idée reçue, le nombre de lamelles du diahragme d'un objectif joue un rôle négligeable dans le bokeh : si, par le contour de son ouverture, le diaphragme détermine la "circularité" du cercle de confusion, il ne répartit pas la luminosité du disque que ce cercle circonscrit.
Un peu d'étymologie, pour terminer. Certains estiment que le terme bokeh proviendrait du japonais  ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...
ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...

(photo Laurent A)
OMIFO
Adaptateur macro pour objectif Elmar 9cm f/4 sur boîtier vissant, permettant un rapport de reproduction 1:4
Commercialisé de 1939 à 1952

VTROO
Adaptateur de réglage de diaphragme pour Summicron f:2/50mm.
Se monte en le vissant comme un filtre (E39), permet le réglage aisé du diaphragme lors d'utilisation avec un système de prise de vue de reproduction (Focoslide).
Fait également office de pare-soleil.
VTROO/16686
Commercialisé en 1956.
OZTNO
Adaptateur se vissant sur le déclencheur de boîtiers Leica M argentiques, afin de pouvoir utiliser un câble déclencheur souple à cloche (destiné aux boîtiers à vis) ou autres accessoires tel le retardateur APDOO par exemple.
Référence numérique : 14088
VALOO
Adaptateur de réglage de diaphragme pour Elmar f:3,5/5 cm.
VALOO/16620
Permet le réglage aisé du diaphragme lorsque l'Elmar est utilisé comme objectif d'agrandissement ou lors de son utilisation avec un système de prise de vue de reproduction (Focoslide).
Peut faire office de pare-soleil (mais ce n'est pas sa fonction première).
Commercialisé en 1949.
Principe similaire à VTROO
ZQGOO
Bague de mise au point hélicoïdale ZQGOO/16688
utilisée sur appareil de mise au point à glissière FOCOSLIDE.

Versions similaires:
ZOOXY pour Elmar 5cm
VSPOO/16685 pour Summicron 50mm
OOZAB
Dispositif de mise au point à glissière pour Leica à vis (couramment nommé "Focoslide"), apparu en 1938, destiné à être monté sur un statif. Le cadrage et la mise au point s’effectuent sur un verre finement dépoli, à travers une loupe droite ou à visée redressée, puis la glissière est manœuvrée et le boîtier se substitue dans l’axe optique pour la prise de vue.
Ci-dessous, version OOZAB-G pour boîtier Leica IIIg :

Ci-dessus un modèle avec fixation du boîtier en "H" (de 1951 à 1957).
OUFRO
Bague adaptarice OUFRO/16469
Bague intermédiaire pour l'emploi des objectifs à baïonnette de distance focale 50 mm et 35 mm sur les chambres Visoflex II et III. Les rapports d’agrandissement sont respectivement 1:1 (à la distance 20,8 cm) et 1,4:1 (à la distance 14,4 cm).
R10
Futur reflex Leica ?
Lire cette page.
Leica M8.2
Une évolution du Leica M8 présentée en 2008. Cf. cette page.
M8.2
Une évolution du Leica M8 présentée en 2008. Cf. cette page.
S2
Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page
Leica S2
Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page
EKOOZ
Mallette en cuir pouvant recevoir un Leica à vis (jusqu'au IIIf), 6 objectifs et de nombreux accessoires.

FARUX
Platine rotative destinée à réaliser des photos panoramiques, introduite en 1933.
Sept bagues différentes permettent d’utiliser des objectifs dont la distance focale est comprise entre 2,8 cm et 20 cm (platine fournie avec la bague "5 cm").

Photo © Patrick LG

Photo © Fanfan
VIOOH
Code Leitz à cinq lettres : VIOOH
Référence : 12000
Viseur universel comportant un cadre variable pour des objectifs de 3,5, 5, 8,5, 9 et 13,5 cm ; ajustement de parallaxe (1939-1963) ; cadre de 2,8 cm au moyen de l'additif divergent TUVOO.
La vision est redressée.
Remplaçant du VIDOM (qui procure une vision inversée droite-gauche).

Photo © Vincent D
Voici le profil droit d’un viseur universel VIOOH / 12000 (remarquer à la base le levier correcteur de parallaxe), sur lequel est vissé le cône TUVOO/12005 :

Photo déjà publiée ici.
Pradovit D-1200
Le premier vidéoprojecteur proposé par Leica (2008). Cf. cette page.
SDPOO
Correcteur de viseur pour le Summicron f:2/50 mm à mise au point rapprochée.
Correspond à la référence numérique 14002.

Lunette SDPOO et son étui en cuir COONH/14627
Leica S
Appareil reflex 30x45 numériques. Pour voir l'ensemble des modèles, allez sur cette page.
Note : le S1, un appareil scanner de studio a donné son nom à la gamme pour des raisons historiques sans être un 30x45 numérique.
IDCOO
Sac tout-prêt destiné au Leica M3, permettant de loger le posemètre Leicameter MC demeurant monté sur le boîtier.
Equivaut à la référence numérique 14526.


Photos © lujka
BEOON
Dispositif pour mise au point rapprochée reposant sur le principe de la bague-allonge, convenant à tous modèles de Leica (à vis et "M") équipé d’un objectif de 50 mm de distance focale.
Equivalent numérique : 16511
Bokhe
Le bokeh (ou bo-ke) est une notion plutôt abstraite et assez ardue... Ce terme est utilisé, principalement par les auteurs de langue anglaise, pour qualifier l'impression ressentie en observant l'ensemble des innombrables "points" d'une image qui ne sont pas "au point" ; chacun est en réalité un disque, correspondant à la section d'un cône de lumière formé par l'objectif à partir d'un objet ponctuel (la frontière du disque est nommée "cercle de confusion", c'est la limite à l'intérieur de laquelle l'image du point est "confuse"). Ainsi, le bokeh définit l'aspect d'une image en dehors de la zone de profondeur de champ, c'est-à-dire la "qualité du flou" de cette image (voir un exemple tout en bas).
En raison de l'aberration sphérique résiduelle de l'objectif ("défaut" dont aucun ne peut être totalement dépourvu), chaque disque n'est pas éclairé de façon uniforme ; ces modes d'éclairement sont variables, selon le degré de correction de cette aberration. Un bokeh théoriquement idéal nécessite que la luminosité du cercle de confusion soit répartie selon une courbe de Gauss, décroissant depuis le centre pour se perdre vers la périphérie (figure de gauche) ; tout se passe comme si l'ensemble des disques se fondaient harmonieusement, le flou est progressif et "doux" : le bokeh est estimé beau. Dans le cas contraire (périphérie plus lumineuse que le centre, frontière du disque tranchée : figure de droite), l'aspect de l'image en dehors de la zone de profondeur de champ peut présenter une certaine "structure", qui s'explique par des interférences entre cercles : le bokeh est jugé peu séduisant. Enfin, chez certains objectifs, un phénomène complexe fait que le bokeh peut conférer à l'image une impression de profondeur (effet "3D").
Ces figures illustrent un disque correspondant à la section d'un cône de lumière, selon les deux caractères de bokeh envisagés ci-dessus :

Contrairement à une idée reçue, le nombre de lamelles du diahragme d'un objectif joue un rôle négligeable dans le bokeh : si, par le contour de son ouverture, le diaphragme détermine la "circularité" du cercle de confusion, il ne répartit pas la luminosité du disque que ce cercle circonscrit.
Un peu d'étymologie, pour terminer. Certains estiment que le terme bokeh proviendrait du japonais  ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...
ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...

(photo Laurent A)
FINOT
FINOT/14070 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Déclencheur souple pour Leica à vis
UOORF
La bague UOORF/16508 permet de monter sur le dispositif pour mise au point rapprochée SOOKY-M (ensuite référencé SOMKY/16507) la tête optique dévissable de la deuxième version du Summicron f:2/50 mm.


Photos © Fanfan D.
ADVOO
Dispositif de mise au point rapprochée adaptable au Leica IIIg, introduit en 1959, comportant deux parties :
- une lentille convergente (bonnette) à visser sur tout objectif de distance focale 5 cm (à barillet E39),
- un correcteur de viseur (prisme) à glisser dans la griffe porte-accessoire.
Rapport de reproduction de 1:8 à 1:15
(équivalent en référence numérique : 16503)
Photos © Mak
Remarque : dans l’exemple illustré ci-dessous, une bague intermédiaire (SNHOO / 13078) permet le montage de la bonnette sur l’objectif Summitar f:2/5 cm, à barillet A36 conique (voir la dernière photo).






ORTUX
ORTUX/14068 : lentille correctrice convenant jusqu’au Leica IIIa (monture à visser sur chaque oculaire) et aussi au viseur universel et au télémètre adaptable, selon plusieurs corrections sphériques (de -5 à +4 dioptries).
OPRTO
OPRTO/14060 : lentille correctrice convenant du Leica IIIb au Leica IIIf (monture à emboîtement coiffant les oculaires jumelés), selon plusieurs corrections sphériques (de -5 à +4 dioptries).
OKBZO
OKBZO/14064 : lentille correctrice convenant au Leica IIIg (monture à emboîtement coiffant les oculaires jumelés), selon plusieurs corrections sphériques (de -5 à +4 dioptries).
IWKOO
IWKOO/12502 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique) : pare-soleil pour Super-Angulon f:4/21 mm
POOTR
Filtre polarisant à monture A42, pivotant à 180° avec pare-soleil intégré. La fixation s’effectue par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis. Peinture noire en finition "craquelée".
Référence : 13352
METER
Metraphot MF/L (code Leitz à cinq lettres : METER)
Posemètre photosensible au sélénium destiné au Leica à vis, se glissant dans la griffe porte-accessoires. Deux gammes de sensibilité selon la position d’un levier agissant sur un volet interne.
Un élément enfichable existe, destiné à amplifier quatre fois la quantité de lumière reçue ("booster", code : MBOOW), figurant sur la photo ci-dessous.


Photos © Rénald
SOOPD
Pare-soleil métallique pliant pour Summitar f:2/5 cm, illustré ci-dessous déployé puis replié (servant alors de bouchon d’objectif) ; ce pare-soleil est surnommé barndoor par les leicaïstes anglophones (la "porte de grange") : ça claque et laisse passer les courants d’air !



Photos © vattimo
SOOFM
Pare-soleil du Summicron f:2/5 cm, illustré ci-dessous déployé puis replié (servant alors de bouchon d’objectif) ; ce pare-soleil est surnommé barndoor par les leicaïstes anglophones (la "porte de grange") : ça claque et laisse passer les courants d’air !


(illustrations tirées de ce message)
XOOBZ
Filtre jaune "léger" n° 1 en monture A43 à baïonnette, destiné au Xenon 5 cm 1:1.5
Tous les filtres de la série dédiée au Xenon commencent par les lettres XOO.
Ces filtres sont également utilisables sur le Summarit 5 cm à vis (1949-1960) et Summarit 5 cm en monture M (1954-1960) dont les 3 premières lettres de référence pour leurs filtres à vis (E41) sont également XOO.

Photo © Jean-Pierre Dep
FIRHE
Filtre n°1 jaune clair à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA
FIRHE
FIRMY
FINUS
FIXIO
FPOOW
FCZOO
FIBOB
FDOOH
FIORE


Photo © Jean-Pierre Dep
FIXTA
Filtre n°0 jaune très léger à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA
FIRHE
FIRMY
FINUS
FIXIO
FPOOW
FCZOO
FIBOB
FDOOH
FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep
FIRMY
Filtre n°2 jaune médium à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA
FIRHE
FIRMY
FINUS
FIXIO
FPOOW
FCZOO
FIBOB
FDOOH
FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep
FINUS
Filtre n°3 jaune dense à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA
FIRHE
FIRMY
FINUS
FIXIO
FPOOW
FCZOO
FIBOB
FDOOH
FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep
FIXIO
Filtre n°1 jaune-vert à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA
FIRHE
FIRMY
FINUS
FIXIO
FPOOW
FCZOO
FIBOB
FDOOH
FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep
FPOOW
Filtre orange à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA
FIRHE
FIRMY
FINUS
FIXIO
FPOOW
FCZOO
FIBOB
FDOOH
FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep
FCZOO
Filtre n°1 (léger) pour la prise de vue infrarouge à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA,FIRHE,FIRMY,FINUS,FIXIO,FPOOW,FCZOO,FIBOB,FDOOH,FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep
FIBOB
Filtre n°2 (médium) pour la prise de vue infrarouge à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA
FIRHE
FIRMY
FINUS
FIXIO
FPOOW
FCZOO
FIBOB
FDOOH
FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep
FDOOH
Filtre n°3 (foncé) pour la prise de vue infrarouge à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA
FIRHE
FIRMY
FINUS
FIXIO
FPOOW
FCZOO
FIBOB
FDOOH
FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep
FIORE
Filtre UVa à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)
Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.
La série complète se décline sous les références ci-après :
FIXTA
FIRHE
FIRMY
FINUS
FIXIO
FPOOW
FCZOO
FIBOB
FDOOH
FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep
SNHOO
Bague d’adaptation (apparue en 1957) permettant d’utiliser les filtres E39 (39 mm de diamètre) sur l'objectif Summitar f:2/5 cm dont la monture de filtre est conique (type « L »).
(équivalent en référence numérique : 13078)
OTXBO
Loupe de visée pour chambre reflex Visoflex II procurant une image redressée.
L’oculaire possède une monture hélicoïdale permettant de l’adapter à sa vue (grandissement 4x).
(équivalent en référence numérique : 16460)


Photos © pepe4243
ZHOOR
(référence numérique : 17640)
Pièce d’inclinaison du porte-film, faisant partie du dispositif de redressement des lignes fuyantes ZESOO/17655 adaptable aux agrandisseurs Leitz Valoy II et Focomat Ia et Ic.
ZFOOT
(référence numérique : 17650)
Support à rotule pour le margeur, faisant partie du dispositif de redressement des lignes fuyantes ZESOO/17655 adaptable aux agrandisseurs Leitz Valoy II et Focomat Ia et Ic.
FNOOY
Filtre rouge "léger" destiné au Summar f:2/5 cm.
FCOOI
Filtre rouge "moyen" destiné au Summar f:2/5 cm.
FNUOO
Filtre rouge "sombre" destiné au Summar f:2/5 cm.
BOOWU-M
BOOWU-M/16526 (code Leitz à 5 lettres, puis référence numérique)
Dispositif permettant la photographie rapprochée aux rapports 1:4 (A6), 1:6 (A5) et 1:9 (A4) au moyen de trois bagues-allonge (chacune correspondant à l’un de ces rapports) et de quatre tiges extensibles servant de support pyramidal, se vissant dans ces bagues et dont les extrémités délimitent le cadrage. Convient à tous les Leica "M" et aux objectifs à baïonnette de distance focale 50 mm et d’ouverture inférieure ou égale à f:2.

Photo © Paul Mortini
LYKUP
Boîtier Leica II (dit "Couplex") laqué noir équipé de l’objectif Elmar f:3,5/5 cm (code attribué de 1932 à 1934).
TZFOO
Tube destiné à monter un objectif Telyt sur un boîtier Leica à vis afin de se passer de la chambre Visoflex (référence ayant succédé à TZOON) ; les références numériques sont 14023 et 14039 (filetage pour trépied respectivement au pas de 1/4’ et 3/8' ).
WEISU
Viseur pour objectif de distance focale 3,5 cm, apparu en 1933.
La photo ci-dessous correspond à la première version (chromée ou laquée noir).
La deuxième version (uniquement chromée) ne possède pas de moulure frontale.

Photo © Mahé charles
FARBA
Filtre (n° 301) pour le procédé Agfacolor destiné à l’objectif Hektor f:1,9/7,3 cm.
FOOSM
Filtre (n° 307) pour le procédé Agfacolor destiné à certains objectifs de la deuxième version du Summar f:2/5 cm (la version "rentrante").
SUMUS
Deuxième version du Summar f:2/5 cm (la version "rentrante") ; objectif fabriqué de 1934 à 1940.
FIUNS
Filtre à emboîtement et vis de serrage pour objectifs en A36 (Elmar f:3,5/3,5 cm et Elmar f:3,5/5 cm)
de teinte jaune très pâle (n° 0).
ANZOO
Calibre destiné à découper l’amorce du rouleau de film destiné au Leica 250, dit "Reporter".
PLOOT
Chambre reflex à miroir pour Leica à vis
Première chambre reflex, possédant un viseur vertical (x5) fournissant une image inversée droite-gauche, et une loupe escamotable (x30) ; cette dernière permet une mise au point extrêmement précise sur l'image aérienne (le verre dépoli possédant une pastille centrale claire avec un réticule) ; un double câble permet le relèvement du miroir et le déclenchement de l'obturateur. Nombreuses variations. Disponible entre 1935 et 1951, précurseur du système Visoflex.
Rendez-vous ici pour en savoir plus.
MQUOO
Déclencheur souple pour Leica à vis destiné à être actionné par la bouche (introduit en 1954).
Référence numérique : 14084
M-P
M-P type 240 : variation du Leica M type 240, voir cette page.
SOMNI
Deuxième version du Summicron f:2/50 mm, dans sa variante à mise au point rapprochée comportant un correcteur de viseur amovible. Objectif fabriqué entre 1956 et 1968. Voir ici (en bas). Référence numérique : 11918.
D-Lux type 109
Appareil numérique compact. Cf. cette page.
X-E type 102
Appareil numérique compact muni d'un objectif fixe de 24 mm f/2,8. Cf. cette page.
S type 006
Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page
S-E type 006
Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page
S type 007
Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page
FONOT
FONOT/14067 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Déclencheur souple comportant une vis de blocage, longueur 25 cm, apparu en 1955.
Convient aux Leica "M", Leicaflex et Leica "R".


Photos © bulb
HOOAR
Filtre jaune très léger (n° 0) vissant, au diamètre 39 mm (monture E39).
(code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 13081)

Photo © bulb
HOOGU
Filtre orange vissant, au diamètre 39 mm (monture E39).
(code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 13101)

Photo © bulb
TOWIN
Dispositif d’accouplement vertical dit "Leica tandem", prévu par Leitz New York (1949-1950) pour deux boîtiers Leica IIIc, afin de permettre :
- la photographie stéréoscopique,
- la photographie simultanée avec deux films ou deux objectifs différents.

TROOV
Courroie de poignet (apparue en 1938) s'arrimant par un boulon au trou taraudé de la semelle du boîtier.

SUOOQ
Viseur pliant procurant le champ d’un objectif de distance focale 2,8 cm, à miroir concave "perforé", c’est-à-dire argenté en périphérie et ménageant un vaste rectangle clair permettant le passage de l’image et le collimatage du cadre à l’infini.
Ce viseur, apparu en 1934, existe en deux finitions : laqué noir et chromé.

Photo © Jean D.






Photos © Gil_78-2B
ELANG
Ce code correspond à l'objectif vissant Leitz Elmar f:4/9 cm.
Ci-dessous, un objectif fabriqué en 1934 :


Photos © Gil_78-2B
IRZOO
Bague intermédiaire à baïonnette permettant d’utiliser un objectif à vis de distance focale 50 mm
sur un boîtier Leica "M", faisant apparaître dans le viseur le cadre correspondant.
Référence numérique : 14097
La bague située à gauche correspond à IRZOO :

Photo © Mahé Charles
ISBOO
Bague intermédiaire à baïonnette permettant d’utiliser un objectif à vis de distance focale 90 mm
sur un boîtier Leica "M", faisant apparaître dans le viseur le cadre correspondant.
Référence numérique : 14098

Photo © maddav
La bague située au milieu correspond à ISBOO :

Photo © Mahé Charles
ISOOZ
Bague intermédiaire à baïonnette permettant d’utiliser un objectif à vis de distance focale 135 mm
sur un boîtier Leica "M", faisant apparaître dans le viseur le cadre correspondant.
Référence numérique : 14099
La bague située à droite correspond à ISOOZ :

Photo © Mahé Charles
BELUN
Dispositif permettant la photographie au rapport 1:1 reposant sur le principe de la bague-allonge, destiné à être utilisé avec un objectif Elmar f:3,5/5 cm (à vis) ; le champ couvert (24x36 mm) s’inscrit dans un rectangle découpé dans une platine reliée par trois tiges à l’objectif (fixation par collier de serrage).
Ci-dessous, dispositif BELUN monté sur un Leica IIIf :

Photo © Piga
BEHOO
Dispositif permettant la photographie selon trois rapports (1:1,5 / 1:2 / 1:3) reposant sur le principe de la bague-allonge (trois bagues différentes), destiné à être utilisé avec les objectifs Elmar f:3,5/5 cm (à vis) et Summar f:2/5 cm ; le champ couvert est délimité par les extrémités de quatre tiges, extensibles selon le rapport choisi, pouvant servir de support pyramidal (fixation à l’objectif par collier de serrage).
Fabriqué de 1935 à 1959.
Ci-dessous, le dispositif BEHOO (dans sa configuration 1:1,5) monté sur un Leica IIIf et un Leica I :

Photo © Piga

Photo © Stéphane Marco
C4DV
Club Des Doux Dingues De Vissants
Pour plus d'informations sur le C4DV : lire ce document.
LENEU
Leica I (modèle C), fabriqué de 1930 à 1933.
Le même code Leitz à cinq lettres s’applique quelle que soit la monture d’objectif (non standardisée puis standardisée).
LOOHW
Leica IIIc, fabriqué de 1940 à 1951 (voir ici).
UOOZK
Bague permettant le montage des têtes des objectifs suivants sur le dispositif à soufflet :
Summicron f:2/90 mm (mise au point entre les rapports 1:25 et 1:1)
Elmarit f:2,8/135 mm (mise au point entre les rapports 1:17 et 1:1,25)
Telyt f:4/200 mm (mise au point de l’infini jusqu’au rapport 1:3)
Telyt f:4,8/280 mm (mise au point de l’infini jusqu’au rapport 1:6)
(équivalent en référence numérique : 16598)
TXBOO
Tube destiné à monter un objectif Telyt sur un boîtier Leica "M" afin de se passer de la chambre Visoflex.
Références numériques équivalentes : 14024 et 14043 (filetage pour trépied respectivement au pas de 1/4’ et 3/8' )
THMOO
Pare-soleil destiné à l’objectif Telyt f:5/40 cm (première version)
(apparu en 1951 / l’objectif était livré avec)
TMEOO
Pare-soleil destiné à l’objectif Telyt f:5/40 cm (deuxième version)
(apparu en 1954 / l’objectif était livré avec)
OROLF
Tourelle pouvant recevoir trois objectifs à vis, destinée aux Leica M3 et M2.
Ce dispositif à tourelle rotative permet de changer rapidement d'objectif
en tournant un gros bouton axial situé sur l’arrière.
Le boîtier est monté sur une semelle qui remplace la semelle d’origine.
Une robuste poignée permet de soutenir et manipuler l’ensemble.
(1960, 250 exemplaires fabriqués)

(photo déjà publiée ici)
FIGRO
Filtre jaune léger n° 1 (monture à emboîtement de type A36) introduit en 1936.
La référence numérique 13005 fut ensuite attribuée.

Photo © mcintosh
KINOR
Viseur pour usage cinématographique avec des cadres pour des objectifs de 15, 25, 50, 75 et 100 mm (1931).





Photos © bobo75
14380 - Lentille correctrice +1,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14381 - Lentille correctrice +2,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14382 - Lentille correctrice +3,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14383 - Lentille correctrice -1,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14384 - Lentille correctrice -2,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14385 - Lentille correctrice -3,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14412 - Chargeur pour pack d'alimentation 14250 (230 V)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14416 - Chargeur pour pack d'alimentation 14250 (tous pays)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14254 - Déclencheur électrique 30 cm R8/R9
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14076 - Déclencheur souple 50 cm
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
10096 - Leica R9 + Vario-Elmar-R 35-70 mm f/4 Macro (kit)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/R9.html.
11344 - Summilux-R 50 mm f/1,4 (II)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/r50_1_4.htm.
11345 - Summicron-R 50 mm f/2 (II, avec ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Summicron50.htm.
11347 - Macro-Elmarit-R 60 mm f/2,8 (avec ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/MacroElmarit60.htm.
11349 - Summilux-R 80 mm f/1,4 (avec ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Summilux80.htm.
11350 - Apo-Summicron-R 90 mm f/2 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoSummicron90.htm.
11352 - Apo-Macro-Elmarit-R 100 mm f/2,8 (avec ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoMacroElmarit100.htm.
16545 - Elpro 1:2 - 1:1 pour Apo-Macro-Elmarit-R 100 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/notice_elpro.htm.
11354 - Apo-Summicron-R 180 mm f/2 (avec ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoSummicron180.htm.
11357 - Apo-Elmarit-R 180 mm f/2,8 (adapté à l'Apo-Extender-R 1,4 x)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/r180_2_8.htm.
11360 - Apo-Telyt-R 280 mm f/4 (avec ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt280.htm.
11365 - Vario-Elmarit-R 28-90 mm f/2,8-4,5 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmarit28-90.htm.
11277 - Vario-Elmar-R 35-70 mm f/4 Macro
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmar35-70.htm.
11281 - Vario-Elmar-R 80-200 mm f/4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmar80-200.htm.
11279 - Vario-Apo-Elmarit-R 70-180 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioApoElmarit70-180.htm.
11268 - Vario-Elmar-R 105-280 mm f/4,2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmar105-280.htm.
11841 - Tête d'objectif Apo-Telyt-R 280/400/560
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.
11842 - Tête d'objectif Apo-Telyt-R 400/560/800
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.
11843 - Focus-Module-R 2,8/280/400
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.
11844 - Focus-Module-R 4/400/560
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.
11845 - Focus-Module-R 5,6/560/800
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.
14525 - Mallette pour Apo-Telyt-Modul-R (tête 280/400/560 avec module)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.
10501 - Leica M7 0,58 chromé noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7.html.
30888 - Leica Pradovit RT-s (commutable 120-240 V/50-60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitRT.html.
30889 - Leica Pradovit RT-m (commutable 120-240 V/50-60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitRT.html.
10503 - Leica M7 0,72 noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7.html.
10504 - Leica M7 0,72 chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7.html.
10546 - Leica M7 0,72 noir + Summicron-M 50 mm f/2 (kit)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7.html.
10302 - Leica MP 0,72 laqué noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp2003.html.
10301 - Leica MP 0,72 chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp2003.html.
10570 - Leica M7 Titane 50 ans + Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. en titane
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7-titane.html.
10572 - Leica M7 Titane 50 ans + 28 mm, 50 mm et 90 mm en titane
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7-titane.html.
12571 - Pare-soleil
IROOA/12571 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Pare-soleil conique pour objectifs de distance focale 35 et 50 mm en monture (pour filtres) E39, apparu en 1959 ; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés. Base chromée, cône métallique noir.

L'IROOA/12571 est le pare-soleil de droite (l'autre est un ITDOO). Photos Philippe D. (ci-dessus) et bulb (ci-dessous).


12580 - Pare-soleil cylindrique pour Elmar f:3,5/5 cm et f:2,8/50 mm en monture E39
Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=ITOOY.
12575 - Pare-soleil cylindro-conique pour objectifs de distance focale 90 et 135 mm en monture E39
Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=IUFOO.
12007 - Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 28 mm
Ci-dessous la dernière version de ce viseur, en finition noire avec son étui en cuir :


Photos © rodolph M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=SLOOZ.
14092 - Courroie de cou en cuir noir

Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=TSOOV.
11210 - Apo-Macro-Elmarit-R 100 mm f/2,8 (sans ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoMacroElmarit100.htm.
18601 - Batterie 1400 mAh pour Digilux 1 ou Digilux 2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/Digilux2.html.
18530 - Lentille correctrice +1,0 dpt pour Minilux ou Minilux Zoom
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/Minilux.html.
18531 - Lentille correctrice -1,0 dpt pour Minilux ou Minilux Zoom
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/Minilux.html.
14330 - Lentille correctrice +0,5 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14331 - Lentille correctrice +1,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14333 - Lentille correctrice +2,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14334 - Lentille correctrice +3,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14335 - Lentille correctrice -0,5 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14336 - Lentille correctrice -1,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14338 - Lentille correctrice -2,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14339 - Lentille correctrice -3,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
10555 - Leica 0, Oskar Barnack Edition
Produit décrit sur https://www.summilux.net/avis/Leica0.html#replique2004.
14408 - Motor-M pour MP (2003), M7, M6 TTL, M6, M4-P, M4-2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14450 - Leicavit M chromé noir pour MP (2003), M7, M6 TTL, M6, M4-P, M4-2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14008 - Leicavit M chromé argent pour MP (2003), M7, M6 TTL, M6, M4-P, M4-2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14009 - Leicavit M laqué noir pour MP (2003), M7, M6 TTL, M6, M4-P, M4-2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
11625 - Tri-Elmar-M 28-35-50 mm f/4 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/TriElmarMAsph.html.
11822 - Noctilux-M 50 mm f/1 noir (1994-2008)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/NoctiluxM50.html.
11891 - Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummiluxM50Asph.html.
11826 - Summicron-M 50 mm f/2 noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummicronM50.html.
11816 - Summicron-M 50 mm f/2 chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummicronM50.html.
11831 - Elmar-M 50 mm f/2,8 rentrant noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/ElmarM50.html.
11823 - Elmar-M 50 mm f/2,8 rentrant chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/ElmarM50.html.
11807 - Elmarit-M 90 mm f/2,8 noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/ElmaritM90.html.
11808 - Elmarit-M 90 mm f/2,8 chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/ElmaritM90.html.
11633 - Macro-Elmarit-M 90 mm f/4 noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/MacroElmarM90.html.
11634 - Macro-Elmarit-M 90 mm f/4 chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/MacroElmarM90.html.
14409 - Macro-Adapter-M pour Macro-Elmarit-M 90 mm f/4
Accessoire du LEICA MACRO-ELMAR-M 1:4/90 mm, cet adaptateur permet d’atteindre une distance de mise au point comprise entre 0,77 m (soit un rapport 1:6,7)
et 0,5 m (soit un rapport 1:3 et une taille d’objet minimum de 72 x 108 mm). Il transmet la position de la came du télémètre de l’objectif de l’appareil photo. La lunette de visée corrige la parallaxe entre le viseur et l’objectif. L’adaptateur est installé sur l’appareil photo et l’objectif se monte «à l’envers» sur l’adaptateur, ce qui permet l’utilisation de la deuxième échelle de profondeur de champ gravée sur le fût de l’objectif pour les prises de vues rapprochées.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/MacroElmarM90.html.
11884 - Apo-Summicron-M 90 mm f/2 Asph. noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/ApoSummicronM90Asph.html.
11885 - Apo-Summicron-M 90 mm f/2 Asph. chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/ApoSummicronM90Asph.html.
11892 - Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummiluxM50Asph.html.
14350 - Lentille correctrice +0,5 dpt pour Leica M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14351 - Lentille correctrice +1,0 dpt pour Leica M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14353 - Lentille correctrice +2,0 dpt pour Leica M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14354 - Lentille correctrice +3,0 dpt pour Leica M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14355 - Lentille correctrice -0,5 dpt pour Leica M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14356 - Lentille correctrice -1,0 dpt pour Leica M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14358 - Lentille correctrice -2,0 dpt pour Leica M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14359 - Lentille correctrice -3,0 dpt pour Leica M
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14870 - Sac tout-prêt pour Leica MP (2003), M7, M6 TTL ou M6
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14856 - Sac tout-prêt pour Leica MP (2003) avec Leicavit-M et manivelle
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14232 - Bouchon avant A70 pour PC-Super-Angulon-R 28 mm f/2,8
14233 - Bouchon avant A74 pour Vario-Elmar-R 28-70 mm f/3,5-4,5 et 35-70 mm f/4
14341 - Bouchon avant A80
14290 - Bouchon avant E60
14298 - Bouchon avant E100 pour Apo-Summicron-R 180 mm f/2
14269 - Bouchon arrière d'objectif M

Leica a remplacé, vers 2012, ce bouchon par le modèle 14379 orné du logo de la marque.
12437 - Parasoleil pour Vario-Elmar-R 35-70 mm f/4 ou 28-70 mm f/3,5-4,5
12590 - Parasoleil pour tête Apo-Telyt-R 400/560/800
12526 - Parasoleil pour Summicron-M 35 mm f/2 Asph., avec bouchon 14043
12549 - Parasoleil pour Elmar-M 50 mm f/2,8 rentrant chromé argent
12550 - Parasoleil pour Elmar-M 50 mm f/2,8 rentrant anodisé noir
13381 - Filtre UV E60
13406 - Filtre polarisant circulaire E60
30421 - Leica Pradovit P150 + Hektor P2 85 mm f/2,8 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30422 - Leica Pradovit P150 + Colorplan P2 90 mm f/2,5 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30842 - Leica Pradovit P150 IR + Hektor P2 85 mm f/2,8 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30843 - Leica Pradovit P150 IR + Colorplan P2 90 mm f/2,5 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30820 - Leica Pradovit P300 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.
30821 - Leica Pradovit P300 + Hektor P2 85 mm f/2,8 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.
30830 - Leica Pradovit P300 IR (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.
30831 - Leica Pradovit P300 IR + Hektor P2 85 mm f/2,8 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.
37510 - Elmarit-P2 60 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37512 - Colorplan-P2 90 mm f/2,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37514 - Super-Colorplan-P2 90 mm f/2,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37515 - Elmaron-P2 120 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37516 - Elmarit-P2 150 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37521 - Elmaron-P2 250 mm f/4 (pour Pradovit P300/P300 IR)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37518 - Vario-Elmarit-P2 70-120 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37524 - Vario-Elmaron-P2 110-200 mm f/3,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37844 - Carton de 10 boîtes de deux paniers 36 vues pour diapositives
37855 - Carton de 10 boîtes de deux paniers 50 vues pour diapositives
37979 - Carton de 10 boîtes de deux paniers LKM 60 vues pour diapositives
37980 - Carton de 10 boîtes de deux paniers LKM 80 vues pour diapositives
37321 - Mallette pour Pradovit P150
37313 - Lampe de lecture pour Pradovit P300
37318 - Télécommande 3 m avec flèche lumineuse pour Pradovit P300
37327 - Panier circulaire 120 vues pour Pradovit P600
37320 - Télécommande 3 m avec flèche lumineuse pour Pradovit P600
37229 - Condenseur pour Pradovit P600, pour montage des objectifs de 200, 250 et 110-200 mm
37323 - Mallette pour Pradovit P300/P600
Produit décrit sur https://www.summilux.net/documents/MallettePradovitP300-600.jpg.
37319 - Rallonge 10 m pour télécommande Pradovit P300/P600
37329 - Rallonge de glissière, pour coupler 2 paniers, Pradovit P300/P600 avec focale supérieure à 120 mm
37997 - Dispositif de fondu enchaîné DU-24 M2 (curseur manuel) pour Pradovit P300/P600/P2002
37996 - Dispositif de fondu-enchaîné DU-24 MT (avec minuterie) pour Pradovit P150 DU/P300/P600/P2002/PC
37325 - Support pour deux Pradovit P300/P600/PC
37011 - Elmarit-P 50 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37633 - Kit haut rendement pour Pradovit P2002/2000/Color 2/2502
37540 - Manchon pour focale de 35 à 200 mm, pour Pradovit P2002/2000/Color 2/2502
37223 - Condenseur pour Pradovit P2002/2000/Color 2/2502, pour montage 35 mm
37224 - Condenseur pour Pradovit P2002/2000/Color 2/2502, pour montage 50 à 200 mm
37226 - Lentille asphérique pour Pradovit P2002/2000/Color 2/2502 (format 4x4 cm)
37227 - Condenseur pour Pradovit P2002/2000/Color 2/2502, pour montage 60 à 200 mm, format 4x4 cm
37939 - Télécommande 3m pour Pradovit P2002/2000/Color 2/2502
37644 - Câble secteur pour Pradovit P2002/2000/Color 2/2502
37369 - Panier circulaire 80 vues pour Pradovit RT
37779 - Ampoule 82 V / 300 W pour Pradovit RT
37354 - Colorplan-Pro 90 mm f/2,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37355 - Super-Colorplan-Pro 90 mm f/2,5
37356 - Elmarit-Pro 120 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37357 - Elmarit-Pro 150 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37358 - Elmaron-Pro 200 mm f/3,4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37360 - Vario-Elmaron-Pro 100-300 mm f/3,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37361 - PC-Elmarit-Pro 60 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37362 - PC-Elmarit-Pro 90 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37363 - Vario-Elmarit-Pro 70-120 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
11777 - Summilux-R 50 mm f/1,4 (I, R)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/SummiluxR50-I.html.
11216 - Summicron-R 50 mm f/2 (II, sans ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Summicron50.htm.
11253 - Macro-Elmarit-R 60 mm f/2,8 (sans ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/MacroElmarit60.htm.
11881 - Summilux-R 80 mm f/1,4 (sans ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Summilux80.htm.
11254 - Summicron-R 90 mm f/2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Summicron90.htm.
11154 - Elmarit-R 90 mm f/2,8 (II, R)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ElmaritR90-II.html.
11232 - Macro-Elmar-R 100 mm f/4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/MacroElmar100.htm.
11270 - Macro-Elmar-R 100 mm f/4, pour soufflet uniquement
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/MacroElmar100.htm.
11923 - Elmarit-R 180 mm f/2,8 (II, sans ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ElmaritR180-II.html.
11242 - Apo-Telyt-R 180 mm f/3,4 (sans ROM, depuis 1976)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt180.htm.
11922 - Elmar-R 180 mm f/4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Elmar180.htm.
11925 - Telyt-R 250 mm f/4 (II)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/TelytR250-II.html.
11263 - Apo-Telyt-R 280 mm f/2,8 (avec tiroir à filtre E55)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt280-2.8-ancien.html.
11915 - Telyt-R 350 mm f/4,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Telyt350.htm.
11260 - Apo-Telyt-R 400 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt400-2.8-ancien.html.
11953 - Telyt-R 400 mm f/6,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Telyt400.htm.
11926 - Telyt-R 400 mm f/6,8 (système Novoflex)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Telyt400N.htm.
11243 - MR-Telyt-R 500 mm f/8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/MRTelyt500.htm.
11927 - Telyt-R 560 mm f/6,8 (système Novoflex)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Telyt560N.htm.
11921 - Telyt-S 800 mm f/6,3
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Telyt800.htm.
11265 - Vario-Elmar-R 28-70 mm f/3,5-4,5 (sans ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmar28-70.htm.
11246 - Vario-Elmar-R 70-210 mm f/4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmar70-210.htm.
11846 - Apo-Telyt-Modul-R 280 mm f/2,8 (11841 + 11843)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt280-2.8.html.
11847 - Apo-Telyt-Modul-R 400 mm f/2,8 (11842 + 11843)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt400-2.8.html.
11857 - Apo-Telyt-Modul-R 400 mm f/4 (11841 + 11844)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt400-4.html.
11848 - Apo-Telyt-Modul-R 560 mm f/4 (11842 + 11844)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt560-4.html.
11858 - Apo-Telyt-Modul-R 560 mm f/5,6 (11841 + 11845)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt560-5.6.html.
11849 - Apo-Telyt-Modul-R 800 mm f/5,6 (11842 + 11845)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt800-5.6.html.
11218 - Summicron-R 50 mm f/2 (I, 1 came)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/SummicronR50-I.html.
11228 - Summicron-R 50 mm f/2 (I, 2 cames)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/SummicronR50-I.html.
11215 - Summicron-R 50 mm f/2 (II, Leicaflex et R)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Summicron50.htm.
11675 - Summilux-R 50 mm f/1,4 (I, SL)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/SummiluxR50-I.html.
11776 - Summilux-R 50 mm f/1,4 (I, SL, SL2 et R)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/SummiluxR50-I.html.
11343 - Summilux-R 50 mm f/1,4 (I, avec ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/SummiluxR50-I.html.
11205 - Macro-Elmarit-R 60 mm f/2,8 (I)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/MacroElmarit60.htm.
11212 - Macro-Elmarit-R 60 mm f/2,8 (SL, SL2, R)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/MacroElmarit60.htm.
11880 - Summilux-R 80 mm f/1,4 (SL, SL2, R)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Summilux80.htm.
11229 - Elmarit-R 90 mm f/2,8 (I, 1 came)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ElmaritR90-I.html.
11239 - Elmarit-R 90 mm f/2,8 (I, 3 cames)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ElmaritR90-I.html.
11806 - Elmarit-R 90 mm f/2,8 (II, SL, SL2 et R)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ElmaritR90-II.html.
11240 - Apo-Telyt-R 180 mm f/3,4 (sans ROM, avant 1976)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt180.htm.
11358 - Apo-Telyt-R 180 mm f/3,4 (avec ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt180.htm.
11356 - Elmarit-R 180 mm f/2,8 (II, avec ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ElmaritR180-II.html.
11909 - Elmarit-R 180 mm f/2,8 (I, 1 came)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ElmaritR180-I.html.
11919 - Elmarit-R 180 mm f/2,8 (I, 2 cames)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ElmaritR180-I.html.
11273 - Apo-Elmarit-R 180 mm f/2,8 (non adapté à l'Apo-Extender-R 1,4 x)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/r180_2_8.htm.
11271 - Apo-Summicron-R 180 mm f/2 (sans ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoSummicron180.htm.
11920 - Telyt-R 250 mm f/4 (I)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/TelytR250-I.html.
11245 - Apo-Telyt-R 280 mm f/2,8 (avec filtre E112)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt280-2.8-ancien.html.
11261 - Apo-Telyt-R 280 mm f/4 (sans ROM)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt280.htm.
18102 - Leica Digilux zoom (230 V)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/index.html.
18103 - Leica Digilux zoom (110 V)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/index.html.
18200 - Leica Digilux 4.3 (230 V, sortie PAL)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/index.html.
18201 - Leica Digilux 4.3 (110 V, sortie NTSC)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/index.html.
10433 - Leica M6 TTL 0,72 chromé noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m6ttl.html.
10434 - Leica M6 TTL 0,72 chromé argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m6ttl.html.
10505 - Leica M7 0,58 chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7.html.
10303 - Leica MP 0,58 chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp2003.html.
10305 - Leica MP 0,85 chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp2003.html.
10436 - Leica M6 TTL 0,85 chromé noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m6ttl.html.
30698 - Leica Pradovit P2002 (commutable 110-240 V/50-60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP2002.html.
10318 - Leica MP3 LHSA laqué noir avec Summilux 50 et Leicavit
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp3-lhsa.html.
10319 - Leica MP3 LHSA chromé argent avec Summilux 50 et Leicavit
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp3-lhsa.html.
11627 - Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. LHSA laqué noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp3-lhsa.html.
11628 - Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. LHSA chromé argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp3-lhsa.html.
12586 - Pare-soleil pour Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. LHSA
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp3-lhsa.html.
30950 - Leica Pradovit P600 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.
30970 - Leica Pradovit P600 IR (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.
30852 - Leica Pradovit P600 + Hektor-P2 85 mm f/2,8 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.
30872 - Leica Pradovit P600 IR + Hektor-P2 85 mm f/2,8 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.
30925 - Leica Pradovit P600 (115 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.
30927 - Leica Pradovit P600 IR (115 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.
30926 - Leica Pradovit P600 (240 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.
30928 - Leica Pradovit P600 IR (240 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.
30918 - Leica Pradovit P300 (115 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.
30920 - Leica Pradovit P300 IR (115 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.
30919 - Leica Pradovit P300 (240 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.
30921 - Leica Pradovit P300 IR (240 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.
37310 - Flèche lumineuse enfichable pour Pradovit P150
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/accessoires.html.
30420 - Leica Pradovit P150 (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30840 - Leica Pradovit P150 IR (230 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30912 - Leica Pradovit P150 (115 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30914 - Leica Pradovit P150 IR (115 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30913 - Leica Pradovit P150 + Hektor P2 85 mm f/2,8 (115 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30915 - Leica Pradovit P150 IR + Hektor P2 85 mm f/2,8 (115 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30497 - Leica Pradovit P150 (120 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30498 - Leica Pradovit P150 + Hektor P2 85 mm f/2,8 (120 V/60 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30452 - Leica Pradovit P150 (240 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30453 - Leica Pradovit P150 + Hektor P2 85 mm f/2,8 (240 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30911 - Leica Pradovit P150 IR + Hektor P2 85 mm f/2,8 (240 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
30910 - Leica Pradovit P150 IR (240 V/50 Hz)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.
37304 - Ampoule pour flèche lumineuse enfichable 37310
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/accessoires.html.
37333 - Dispositif lumière du jour pour Pradovit P300 et P600
37335 - Alimentation externe pour télécommande IR de Pradovit P600 IR
37990 - Télécommande à infrarouge IR PCM pour Pradovit P300 ou P600 (non IR)
37631 - Fiche multiprise pour branchement simultané sur Pradovit P300 ou P600
37986 - Minuterie pour Pradovit P300/P300 IR
37513 - Colorplan-P2 CF 90 mm f/2,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37520 - Elmaron-P2 200 mm f/3,4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37523 - Vario-Elmaron-P2 85-150 mm f/4 (pour Pradovit P600/P600 IR)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37522 - Vario-Elmaron-P2 110-200 mm f/3,5 (pour Pradovit P300/P300 IR)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37985 - Capôt pour Pradovit P2002
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP2002.html.
37961 - Mallette pour Pradovit P2002
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitP2002.html.
37632 - Rallonge de glissière, pour coupler 2 paniers, Pradovit P2002
37119 - Manchon d'objectif pour 35-200 mm, Pradovit P2002
37130 - Manchon d'objectif pour 250 mm, Pradovit P2002
34640 - Manchon d'objectif pour 300 mm, Pradovit P2002
37004 - Elmaron-P 60 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37005 - Colorplan-P 90 mm f/2,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37015 - Colorplan-P CF 90 mm f/2,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37085 - Super-Colorplan-P 90 mm f/2,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37022 - Elmaron-P 120 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37017 - Elmarit-P 150 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37009 - Elmaron-P 200 mm f/3,4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37082 - Elmaron-P 250 mm f/4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
34837 - Epnor-P 300 mm f/4,3
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37026 - Vario-Elmaron-P 60-110 mm f/3,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
37027 - Vario-Elmaron-P 110-210 mm f/3,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/objectifs.html.
30891 - Leica Pradovit RT-m (commutable 120-240 V/50-60 Hz, pour USA/Canada)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitRT.html.
30890 - Leica Pradovit RT-s (commutable 120-240 V/50-60 Hz, pour USA/Canada)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitRT.html.
12531 - Viseur d'angle M, pour utilisation avec le Macro-Elmar-M 90 mm f/4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
12035 - Viseur annexe
Viseur annexe "tubulaire" à cadre procurant le champ de la focale 200 mm (code Leitz à 5 lettres : SFTOO) ; compensation de parallaxe graduée en pieds.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=SFTOO.
12037 - Viseur annexe "tubulaire" procurant le champ de la focale 400 mm
Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=SQTOO.
14237 - Déclencheur électrique 30 cm R3/R7
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14159 - Bagues-rallonges, l'ensemble des trois bagues, hauteur de 50 mm
14494 - Chargeur pour batterie de Leica M (type 240)
Chargeur pour batterie 14499 (BC-SCL 2).

549027 - Photar 50 mm f/4
14569 - Sac tout-prêt pour Leica R4 et objectif de 21 à 50 mm
14568 - Sac tout-prêt pour Leica R4 et objectif de 16 à 90 mm
14240 - Lentille correctrice +0,5 dpt pour Leica R3, R4 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14241 - Lentille correctrice +1,0 dpt pour Leica R3, R4 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14243 - Lentille correctrice +2,0 dpt pour Leica R3, R4 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14244 - Lentille correctrice +3,0 dpt pour Leica R3, R4 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14245 - Lentille correctrice -0,5 dpt pour Leica R3, R4 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14246 - Lentille correctrice -1,0 dpt pour Leica R3, R4 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14248 - Lentille correctrice -2,0 dpt pour Leica R3, R4 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14249 - Lentille correctrice -3,0 dpt pour Leica R3, R4 ou Leicaflex SL2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14118 - Lentille correctrice +0,5 dpt pour Leicaflex, Leicaflex SL ou Visoflex III 16499
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14371 - Lentille correctrice +1,0 dpt pour Leicaflex, Leicaflex SL ou Visoflex III 16499
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14373 - Lentille correctrice +2,0 dpt pour Leicaflex, Leicaflex SL ou Visoflex III 16499
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14374 - Lentille correctrice +3,0 dpt pour Leicaflex, Leicaflex SL ou Visoflex III 16499
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14375 - Lentille correctrice -0,5 dpt pour Leicaflex, Leicaflex SL ou Visoflex III 16499
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14376 - Lentille correctrice -1,0 dpt pour Leicaflex, Leicaflex SL ou Visoflex III 16499
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14378 - Lentille correctrice -2,0 dpt pour Leicaflex, Leicaflex SL ou Visoflex III 16499
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14379 - Lentille correctrice -3,0 dpt pour Leicaflex, Leicaflex SL ou Visoflex III 16499
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.
14003 - APDOO/14003 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Retardateur à viser à la place de la collerette du déclancheur. Commercialisé par Leitz de 1938 à 1965
12585 - Pare-soleil prévu pour six objectifs :
Summaron f:3,5/35 mm (monture E 39)
Summaron f:2,8/35 mm
Summicron f:2/35 mm (première version)
Elmar f:3,5/50 mm (monture E 39)
Elmar f:2,8/50 mm
Summicron f:2/50 mm (jusqu'au n° 2974250)
L’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés.

Photo © Kalczuga
12538 - Pare-soleil
Le pare-soleil n° 12538 est prévu pour le Summicron f:2/50 mm (destiné aux objectifs dont les numéros sont compris entre 2915801 et 3649975).
13352 - Filtre polarisant pivotant A42
Filtre polarisant à monture A42, pivotant à 180° avec pare-soleil intégré. La fixation s’effectue par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis. Peinture noire en finition "craquelée".
Code Leitz à cinq lettres : POOTR
11632 - Apo-Summicron-M 90 mm f/2 Asph. titanisé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/ApoSummicronM90Asph.html.
10435 - Leica M6 TTL 0,72 titanisé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m6ttl.html.
11624 - Summicron-M 50 mm f/2 titanisé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummicronM50.html.
22228 - Adaptateur R sur M
Adaptateur pour l'utilisation d'optiques R sur boîtier M.

Photo © Blowupster
Une version moderne de cet adaptateur est proposé sous la référence 14642, pour le Leica M (type 240).
18665 - Etui Néoprène pour Digilux 3 et D Vario-Elmarit 14-50 mm f/2,8-3,5 Asph. ou pour V-Lux 1
Produit décrit sur https://www.summilux.net/4-3/Digilux3.html.
18666 - Etui cordura pour Digilux 3 et D Vario-Elmarit 14-50 mm f/2,8-3,5 Asph. ou pour V-Lux 1
Produit décrit sur https://www.summilux.net/4-3/Digilux3.html.
11642 - Tri-Elmar-M 16-18-21 mm f/4 Asph. + viseur 12011
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/TriElmarM16-18-21Asph.html.
14260 - Dispositif de chargement rapide pour Leica M
Dispositif de chargement rapide pour Leica M3, M2, M1 et MD, commercialisé en 1968, destiné à être monté par l'utilisateur à l'intérieur de la semelle du boîtier (système "poussoir"). Une bobine spéciale (comportant une fente pour insérer l'amorce) remplace la bobine d'origine. Un autocollant explicatif est fourni, devant être appliqué au bas du châssis afin de couvrir le schéma de chargement originel.

Photo © Piga
22233 - Adaptateur d'objectif à monture Minolta SRL sur M
Adaptateur acceptant les objectifs en monture Minolta SRL sur monture M.
Destiné à l'origine pour la caméra Super-8 Leicana Spécial (1972-1977), il peut être utilisé sur Leica M.

11244 - Vario-Elmar-R 35-70 mm f/3,5
Design Minolta
11930 - Vario-Elmar-R 45-90 mm f/4,5
Design Angenieux, objectif commercialisé de 1969 à 1982.
11226 - Vario-Elmar-R 75-200 mm f/4,5
Design Minolta
11224 - Vario-Elmar-R 80-200 mm f/4,5
Design Minolta, objectif commercialisé de 1974 à 1978.
11875 - Summilux-R 50 mm f/1,4 (1969-1978)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/SummiluxR50-I.html.
13414 - Filtre UV/IR E60 noir
11644 - Summarit-M 50 mm f/2,5
Objectif de 50 mm en monture M, anodisation noire.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummaritM50.html.
11646 - Summarit-M 90 mm f/2,5
Objectif de 90 mm en monture M, anodisation noire.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummaritM90.html.
12459 - Parasoleil métal avec bouchon de parasoleil pour Summarit-M 35mm et 50mm f/2,5
Convient aux références 11643 et 11644.
12460 - Parasoleil métal avec bouchon de parasoleil pour Summarit-M 75 et 90 mm f/2,5
Convient aux références 11645 et 11646.
14474 - Bouchon avant d’objectif métal pour Summarit-M 35 et 50 mm f/2,5
Convient aux références 11643 et 11644 (remplacement du bouchon livré d'origine)
14475 - Bouchon avant d’objectif métal pour Summarit-M 75 et 90 mm f/2,5
Convient aux références 11645 et 11646 (remplacement du bouchon livré d'origine)
14476 - Parasoleil pour Summarit-M 35 et 90 mm f/2,5
En remplacement, inclus dans la référence 12459 (parasoleil + bouchon de parasoleil).
14477 - Parasoleil métal pour Summarit-M 75 et 90 mm f/2,5
En remplacement, inclus dans la référence 12460 (parasoleil + bouchon de parasoleil).
11650 - Kit Summarit-M 35 mm + 50 mm f/2,5
11652 - Kit Summarit-M 35 mm + 90 mm f/2,5
11653 - Kit Summarit-M 50 mm + 75 mm f/2,5
11654 - Kit Summarit-M 50 mm + 90 mm f/2,5
11655 - Kit Summarit-M 75 mm + 90 mm f/2,5
11656 - Kit Summarit-M 35 mm + 50 mm + 75 mm f/2,5
11657 - Kit Summarit-M 35 mm + 75 mm + 90 mm f/2,5
11658 - Kit Summarit-M 35 mm + 50 mm + 90 mm f/2,5
11659 - Kit Summarit-M 50 mm + 75 mm + 90 mm f/2,5
11660 - Kit Summarit-M 35 mm + 50 mm + 75 mm + 90 mm f/2,5
12005 - Adapteur 28 mm pour viseur 12000
Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=TUV00.
16556 - Soufflet macro - Bellows II
Soufflet macro II pour Visoflex à baïonnette II ou III.

14442 - Photar 50 mm f/4
14033 - Bouchon de pare-soleil
Bouchon de pare-soleil (coiffant l’objectif en position inversée).
Convient aux pare-soleil IROOA/12571, 12585 et IUFOO/12575.

11602 - Noctilux-M 50 mm f/0,95 Asph., noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/NoctiluxM50Apsh.html.
14002 - Correcteur de viseur
Correcteur de viseur pour le Summicron f:2/50 mm à mise au point rapprochée.
Correspond au code Leitz à cinq lettres SDPOO.
16511 - Bague-allonge pour 50 mm M ou à vis
Dispositif pour mise au point rapprochée reposant sur le principe de la bague-allonge, convenant à tous modèles de Leica (à vis et "M") équipé d’un objectif de 50 mm de distance focale.
Equivalent dans le code Leitz à 5 lettres : BEOON
10801 - Leica S2 noir
Le premier Leica 30 x 45 (capteur de 37,5 Mpix).
Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/S2.html.
11055 - Summarit-S 70 mm f/2,5 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/SummaritS70AsphCS.html.
11051 - Summarit-S 70 mm f/2,5 Asph. CS
Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/SummaritS70AsphCS.html.
11071 - Apo-Tele-Elmar-S 180 mm f/3,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/ApoElmarS180CS.html.
11053 - Apo-Tele-Elmar-S 180 mm f/3,5 CS
Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/ApoElmarS180CS.html.
11070 - Apo-Macro-Summarit-S 120 mm f/2,5
Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/ApoMacroSummaritS120CS.html.
11052 - Apo-Macro-Summarit-S 120 mm f/2,5 CS
Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/ApoMacroSummaritS120CS.html.
16003 - Poignée Multifonctions S
Poignée multifonctions pour Leica S2.

16011 - Chargeur de batterie professionnel S
Chargeur de batterie professionnel pour Leica S2.

Le chargeur S Pro permet d'améliorer et d'assurer que votre système Leica S est toujours prêt à l'emploi. En effet, il peut charger deux accumulateurs simultanément.
12504 - Pare-soleil ajouré
Le pare-soleil n° 12504 convient :
- au Summilux f:1,4/35 mm (première version, c'est-à-dire référence n° 11870 mais à partir du n° 2166701),
- au Summicron f:2/35 mm (deuxième version, c'est-à-dire référence n° 11309).
Ce pare-soleil peut recevoir des filtres de la série VII.

Photo © a.noctilux
16000 - Verre entièrement dépoli pour Leica S2 ou S
Verre standard.

16001 - Verre à microprisme pour Leica S2 ou S
Le verre de mise au point réf. 16 001 possède également, outre la surface dépolie, un cercle intérieur et un anneau à microprisme.

16012 - Câble de déclenchement à distance S

Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/S2.html.
16006 - Courroie de port pour Leica S2 ou S

16015 - Couvercle pour viseur de Leica S2 ou S

16009 - Appareil de charge S
Avec fiche secteur USA intégrée et fiche secteur de rechange EU, UK et AUS, câble de chargement pour allume-cigare.

11124 - Summicron 90 mm f/2 pour Visoflex
Summicron f:2/90 mm en monture courte, destiné à la chambre Visoflex II ou III.
11663 - Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. (2010), noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummiluxM35Asph-2010.html.
16014 - Câble USB pour Leica S2 ou S
Câble USB avec connecteur LEMO® pour Leica S.

16018 - Bouchon avant d’objectif S 72 mm

Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/.
16019 - Bouchon avant d’objectif S ou SL 82 mm

Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/.
16020 - Bouchon arrière d'objectif S

Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/.
14627 - Etui pour correcteur de viseur
Etui pour le correcteur de viseur du Summicron f:2/50 mm à mise au point rapprochée
18176 - Viseur EVF1 pour D-Lux 5
Viseur électronique avec 200 000 points pour un aperçu image 100% même dans des conditions de lumière extrêmes. Possibilité de correction des dioptries. Pour Leica D-Lux 5.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/D-Lux5.html.
14526 - Mallette pour Apo-Telyt-Modul-R (tête 400/560/800 avec module)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.
11914 - Dernière version du Telyt f:4,8/280 mm
14079 - Bouchon d'objectif (A 76)
Destiné au Telyt f:4,8/280 mm.
16503 - Dispositif de mise au point rapprochée
Dispositif de mise au point rapprochée adaptable au Leica IIIg, introduit en 1959, comportant deux parties :
- une lentille convergente (bonnette) à visser sur tout objectif de distance focale 5 cm (à barillet E39),
- un correcteur de viseur (prisme) à glisser dans la griffe porte-accessoire.
Rapport de reproduction de 1:8 à 1:15
(équivalent dans le code Leitz à 5 lettres : ADVOO)
Photos © Mak
Remarque : dans l’exemple illustré ci-dessous, une bague intermédiaire (SNHOO / 13078) permet le montage de la bonnette sur l’objectif Summitar f:2/5 cm, à barillet A36 conique (voir la dernière photo).






10771 - Leica M (type 240) chromé argenté
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m-2012.php.
18707 - Viseur pour Leica X2
Le viseur noir avec cadre lumineux de 35 mm est fixé au support de flash du X2 et procure à tout moment un aperçu net sans consommer d’électricité.

Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/X2.php.
10770 - Leica M (type 240) noir vernis
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m-2012.php.
18751 - Etui cuir pour Leica V-Lux 40
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/V-Lux40.html.
18701 - Batterie BP-DC7-E pour Leica V-Lux 40
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/V-Lux40.html.
18702 - Batterie BP-DC7-U pour Leica V-Lux 40
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/V-Lux40.html.
13078 - Bague adaptation E39 - L (filtres pour Summitar)
Bague d’adaptation (apparue en 1957) permettant d’utiliser les filtres E39 (39 mm de diamètre) sur l'objectif Summitar f:2/5 cm dont la monture de filtre est conique (type « L »).
(équivalent dans le code Leitz à 5 lettres : SNHOO)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=SNHOO.
14642 - Adaptateur R pour Leica M ou M-P (type 240), Monochrom type 246 ou M10

Produit décrit sur https://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=53419.
14634 - Adaptateur microphone pour Leica M (type 240) ou X Vario

Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m-2012.php.
18753 - Viseur électronique Visoflex EVF 2
Viseur électronique Viso-Flex EVF2 pour Leica X2 ou pour Leica M (type 240).

Le viseur électronique Visoflex haute résolution EVF2 offre une résolution de 1,4 millions de pixels et dispose d'une fonction pivotante de 90° pour des angles de prises de vues inhabituels. Lorsque vous l'utilisez, il affiche tous les paramètres de prise de vues importants et permet de procéder à un contrôle précis du sujet, en particulier avec une lumière ambiante très lumineuse. Associé à l'adaptateur R, les objectifs R et le viseur, le Leica M (type 240) peut être utilisé indépendamment de l'écran, comme un appareil reflex.



10803 - Leica S (type 006)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/S-2012.php.
14646 - Passant pour doigts pour poignée M, X ou Q, taille S
Le passant pour doigts permet d'améliorer considérablement la prise en main de l'appareil, en particulier avec des optiques imposantes, en association avec la poignée M multifonction 14495. Cette courroie peut également être utilisée avec la poignée M standard 14496 disponible dans les accessoires. De plus, elle s'adapte à la poignée pour X ou X-Vario (18766) ainsi qu'à la poignée pour Q (19505).
14647 - Passant pour doigts pour poignée M, X ou Q, taille M
Le passant pour doigts permet d'améliorer considérablement la prise en main de l'appareil, en particulier avec des optiques imposantes, en association avec la poignée M multifonction 14495. Cette courroie peut également être utilisée avec la poignée M standard 14496 disponible dans les accessoires. De plus, elle s'adapte à la poignée pour X ou X-Vario (18766) ainsi qu'à la poignée pour Q (19505).
14648 - Passant pour doigts pour poignée M, X ou Q, taille L
Le passant pour doigts permet d'améliorer considérablement la prise en main de l'appareil, en particulier avec des optiques imposantes, en association avec la poignée M multifonction 14495. Cette courroie peut également être utilisée avec la poignée M standard 14496 disponible dans les accessoires. De plus, elle s'adapte à la poignée pour X ou X-Vario (18766) ainsi qu'à la poignée pour Q (19505).
14644 - Bouchon de rail de fixation pour Leica M (type 240)
Bouchon de rail porte-accessoire/flash pour Leica M (type 240)

14547 - Sac tout-prêt pour Leica M (type 240)
14499 - Batterie Li-Ion pour Leica M (type 240)

14495 - Poignée M multifonctions

Grâce à cette poignée multifonctions adaptée au Leica M/M-P type 240 ou type 246, vous pouvez mémoriser le lieu de la prise de vue dans les données d'images EXIF (Geotagging GPS). Pour utiliser simultanément un flash indépendant et un viseur externe sur le Leica M, la poignée multifonction M dispose d'une prise SCA, qui communique avec l'appareil de la même façon que votre rail de fixation. Pour cela, le lot d'adaptateur Leica SCA est utilisé. Ce lot se compose d'un rail de flash et d'un câble en spirale avec un rail de fixation. De plus, la poignée dispose d'une connexion pour l'alimentation externe en courant et une connexion de synchronisation DIN/ISO-X pour des flashs en studio. Un bloc d'alimentation est en option. La connexion USB de la poignée permet de raccorder le Leica M directement à un ordinateur. Avec le logiciel „Leica Image Shuttle", il est possible de commander entièrement à distance l'appareil et de transférer les données d'images sur l'ordinateur via un câble USB. De plus, la poignée M multifonctions garantit une bonne prise en main de l'appareil, en particulier avec l'utilisation d'objectifs R lourds.
11821 - Noctilux-M 50 mm f/1 noir (1976-1994)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/NoctiluxM50.html.
11820 - Noctilux 50 mm f/1,2
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/objectifs/Noctilux50-1.2.html.
16024 - Adaptateur Leica S V
Adaptateur Leica S pour les objectifs du système Hasselblad V.

16025 - Adaptateur Leica S M645
Adaptateur Leica S pour les objectifs du système Mamiya 645.

16026 - Adaptateur Leica S P67
Adaptateur Leica S pour les objectifs du système Pentax 67.

16030 - Adaptateur Leica S H
Adaptateur Leica S pour les objectifs du système Hasselblad H.

16004 - Dragonne S ou SL
La dragonne S se fixe à la poignée multifonctions S ou à la poignée multifonctions SL afin de faciliter considérablement le port et la manipulation de l'ensemble appareil photo / poignée.

16022 - Bloc secteur S (S2, S2-P et S type 006)
Si le Leica S est utilisé à un endroit fixe et/ou pour un très grand nombre de prises de vues pendant une période prolongée, il est utile de garantir l'alimentation de l'appareil en utilisant l'adaptateur secteur S.

16029 - Câble de déclenchement à distance S (S2, S type 006)
Pour éviter tout risque de flou, vous pouvez utiliser le câble de déclenchement à distance électrique S.

16031 - Câble de Synchronisation S
LEMO®, câble de Synchronisation S

11141 - Apo-Summicron-M 50 mm f/2 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/ApoSummicronM50Asph.html.
11629 - Macro-Elmar-M 90 mm f/4 + accessoires
Ensemble composé de l'objectif Macro-Elmar-M 90 mm f/4, du Macro-Adapter-M et du viseur d'angle M.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/MacroElmarM90.html.
16032 - Elpro-S 180

Bonnette Elpro-S 180, adaptée à l'Apo-Elmar-S 180 mm f/3,5
11079 - TS-APO-Elmar-S 120 mm f/5,6 Asph.
TS-APO-Elmar-S 120 mm f/5,6 Asph. à bascule et décentrement.

11058 - Vario-Elmar-S 30-90 mm f/3,5-5,6 Asph.

14397 - Bouchon de boîtier Leica M (type 240)
16037 - Courroie de port Leica S ou SL
En cordura noir.

16469 - Bague adaptarice OUFRO/16469
Bague intermédiaire pour l'emploi des objectifs à baïonnette de distance focale 50 mm et 35 mm sur les chambres Visoflex II et III. Les rapports d’agrandissement sont respectivement 1:1 (à la distance 20,8 cm) et 1,4:1 (à la distance 14,4 cm).
18774 - Para-soleil pour X Vario
Ce pare-soleil se visse sur l'avant du zoom du X Vario (type 107) et améliore le contraste en minimisant les lumières parasites. Le pare-soleil est livré avec un bouchon traditionnel en métal.
18430 - Leica X Vario (type 107)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/XVario-107.php.
18782 - Dragonne noire pour X Vario, Leica M10, ...
Ergonomique, en cuir véritable de qualité.
18783 - Dragonne pour X Vario, Leica M10, ...
Ergonomique, en cuir véritable de qualité.
18776 - Courroie de port noire pour X Vario, Leica M10, ...
En cuir véritable de qualité.

18777 - Courroie de port cognac pour X Vario, Leica M10, ...
En cuir véritable de qualité.

12034 - Viseur annexe
Viseur annexe "tubulaire" à cadre procurant le champ de la focale 200 mm (code Leitz à 5 lettres : SFTOO) ; compensation de parallaxe graduée en mètres.
14101 - Trépied en carbone

20000 - Leica M10 chromé noir

Leica M10 type 3656
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M10.
24016 - Holster en cuir noir pour Leica M10

13030 - Filtre UVA II E39 noir

Filtre UVA II E39 noir

96602 - Tasse à café style Noctilux-M 50

96603 - Tasse à café style Summarit-S 70

96601 - Tasse à café grise

18181 - Leica T type 701, argent anodisé

Produit décrit sur https://www.summilux.net/t_system/t701.php.
18767 - Visoflex type 020 pour Leica T, X ou M10

Viseur électronique intégrant un GPS, adapté au Leica T type 701, au Leica X type 113 et au Leica M10.

18772 - Batterie Lithium-Ion BP-DC 13 (Leica T type 701)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/t_system/accessoires/.
18180 - Leica T type 701, noir anodisé

Produit décrit sur https://www.summilux.net/t_system/t701.php.
16502 - Accessoire de type bague-allonge
Accessoire de type bague-allonge (dérivé du NOOKY / 16500) permettant la photo rapprochée avec un Leica à vis (sauf IIIg) et la première version du Summicron f:2/5 cm (c’est-à-dire le Summicron rentrant) ; la compensation de la parallaxe est assurée. Rapport : 1:8 à 1:17,5.
Code Leitz à cinq lettres équivalent : SOOKY.
14109 - Petite tête à rotule, noire
Voir la définition du grand modèle, référence 14110.

14108 - Petite tête à rotule, argent
Voir la définition du grand modèle, référence 14110.

14112 - Grande tête à rotule, noire
Voir la définition du modèle couleur argent, référence 14110.

11918 - Deuxième version du Summicron f:2/50 mm
Deuxième version du Summicron f:2/50 mm, dans sa variante à mise au point rapprochée comportant un correcteur de viseur amovible. Objectif fabriqué entre 1956 et 1968. Voir ici (en bas). Code Leitz à cinq lettres : SOMNI.
11056 - Summicron-S 100 mm f/2 Asph.

Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/objectifs/.
14010 - Bouton de déclencheur doux, Leica 12 mm rouge

En quelques secondes, le bouton de déclencheur doux augmente la taille du déclencheur de votre appareil photo Leica M et simplifie l'action de déclencher en améliorant le confort de prise de vues. Les boutons de déclencheur doux peuvent également se porter à la boutonnière du veste, ce qui en fait un accessoire doublement élégant. Trois modèles au design intemporel : un logo Leica classique (rouge ou chromé argent), une édition limitée arborant le logo 100 ans ou M réduit à l'essentiel.

Réf. 14010 : Leica, rouge, 12 mm
Réf. 14014 : Leica, rouge, 8 mm
Réf. 14015 : Leica, chrome, 12 mm
Réf. 14016 : Leica, chrome, 8 mm
Réf. 14017 : M, 12 mm
Réf. 14018 : M, 8 mm
Réf. 14019 : 100 ans, 12 mm
14014 - Bouton de déclencheur doux, Leica 8 mm rouge

En quelques secondes, le bouton de déclencheur doux augmente la taille du déclencheur de votre appareil photo Leica M et simplifie l'action de déclencher en améliorant le confort de prise de vues. Les boutons de déclencheur doux peuvent également se porter à la boutonnière du veste, ce qui en fait un accessoire doublement élégant. Trois modèles au design intemporel : un logo Leica classique (rouge ou chromé argent), une édition limitée arborant le logo 100 ans ou M réduit à l'essentiel.

Réf. 14010 : Leica, rouge, 12 mm
Réf. 14014 : Leica, rouge, 8 mm
Réf. 14015 : Leica, chrome, 12 mm
Réf. 14016 : Leica, chrome, 8 mm
Réf. 14017 : M, 12 mm
Réf. 14018 : M, 8 mm
Réf. 14019 : 100 ans, 12 mm
14015 - Bouton de déclencheur doux, Leica 12 mmm chromé

En quelques secondes, le bouton de déclencheur doux augmente la taille du déclencheur de votre appareil photo Leica M et simplifie l'action de déclencher en améliorant le confort de prise de vues. Les boutons de déclencheur doux peuvent également se porter à la boutonnière du veste, ce qui en fait un accessoire doublement élégant. Trois modèles au design intemporel : un logo Leica classique (rouge ou chromé argent), une édition limitée arborant le logo 100 ans ou M réduit à l'essentiel.

Réf. 14010 : Leica, rouge, 12 mm
Réf. 14014 : Leica, rouge, 8 mm
Réf. 14015 : Leica, chrome, 12 mm
Réf. 14016 : Leica, chrome, 8 mm
Réf. 14017 : M, 12 mm
Réf. 14018 : M, 8 mm
Réf. 14019 : 100 ans, 12 mm
14016 - Bouton de déclencheur doux, Leica 8 mm chromé

En quelques secondes, le bouton de déclencheur doux augmente la taille du déclencheur de votre appareil photo Leica M et simplifie l'action de déclencher en améliorant le confort de prise de vues. Les boutons de déclencheur doux peuvent également se porter à la boutonnière du veste, ce qui en fait un accessoire doublement élégant. Trois modèles au design intemporel : un logo Leica classique (rouge ou chromé argent), une édition limitée arborant le logo 100 ans ou M réduit à l'essentiel.

Réf. 14010 : Leica, rouge, 12 mm
Réf. 14014 : Leica, rouge, 8 mm
Réf. 14015 : Leica, chrome, 12 mm
Réf. 14016 : Leica, chrome, 8 mm
Réf. 14017 : M, 12 mm
Réf. 14018 : M, 8 mm
Réf. 14019 : 100 ans, 12 mm
14017 - Bouton de déclencheur doux, M 12 mm

En quelques secondes, le bouton de déclencheur doux augmente la taille du déclencheur de votre appareil photo Leica M et simplifie l'action de déclencher en améliorant le confort de prise de vues. Les boutons de déclencheur doux peuvent également se porter à la boutonnière du veste, ce qui en fait un accessoire doublement élégant. Trois modèles au design intemporel : un logo Leica classique (rouge ou chromé argent), une édition limitée arborant le logo 100 ans ou M réduit à l'essentiel.

Réf. 14010 : Leica, rouge, 12 mm
Réf. 14014 : Leica, rouge, 8 mm
Réf. 14015 : Leica, chrome, 12 mm
Réf. 14016 : Leica, chrome, 8 mm
Réf. 14017 : M, 12 mm
Réf. 14018 : M, 8 mm
Réf. 14019 : 100 ans, 12 mm
14018 - Bouton de déclencheur doux, M 8 mm

En quelques secondes, le bouton de déclencheur doux augmente la taille du déclencheur de votre appareil photo Leica M et simplifie l'action de déclencher en améliorant le confort de prise de vues. Les boutons de déclencheur doux peuvent également se porter à la boutonnière du veste, ce qui en fait un accessoire doublement élégant. Trois modèles au design intemporel : un logo Leica classique (rouge ou chromé argent), une édition limitée arborant le logo 100 ans ou M réduit à l'essentiel.

Réf. 14010 : Leica, rouge, 12 mm
Réf. 14014 : Leica, rouge, 8 mm
Réf. 14015 : Leica, chrome, 12 mm
Réf. 14016 : Leica, chrome, 8 mm
Réf. 14017 : M, 12 mm
Réf. 14018 : M, 8 mm
Réf. 14019 : 100 ans, 12 mm
14019 - Bouton de déclencheur doux, 100 ans 12 mm

En quelques secondes, le bouton de déclencheur doux augmente la taille du déclencheur de votre appareil photo Leica M et simplifie l'action de déclencher en améliorant le confort de prise de vues. Les boutons de déclencheur doux peuvent également se porter à la boutonnière du veste, ce qui en fait un accessoire doublement élégant. Trois modèles au design intemporel : un logo Leica classique (rouge ou chromé argent), une édition limitée arborant le logo 100 ans ou M réduit à l'essentiel.

Réf. 14010 : Leica, rouge, 12 mm
Réf. 14014 : Leica, rouge, 8 mm
Réf. 14015 : Leica, chrome, 12 mm
Réf. 14016 : Leica, chrome, 8 mm
Réf. 14017 : M, 12 mm
Réf. 14016 : M, 8 mm
Réf. 14019 : 100 ans, 12 mm
18454 - Leica X-E type 102
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/XE102.php.
10812 - Leica S-E type 006
Produit décrit sur https://www.summilux.net/s_system/SE006.php.
18471 - Leica D-Lux type 109
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/DL109.php.
11667 - Noctilux-M 50 mm f/0,95 Asph., argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/NoctiluxM50Apsh.html.
11675 - Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. (type 2010), chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummiluxM35Asph-2010.html.
11680 - Summarit-M 50 mm f/2,4 Asph., noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummaritM50II.html.
11681 - Summarit-M 50 mm f/2,4 Asph., argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummaritM50II.html.
11684 - Summarit-M 90 mm f/2,4 Asph., noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummaritM90II.html.
11685 - Summarit-M 90 mm f/2,4 Asph., argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/SummaritM90II.html.
18834 - Etui country pour Visoflex type 020
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/X113.php.
18839 - Dragonne vintage pour X type 113, Leica M10, ...
18835 - Etui vintage pour Visoflex type 020
Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/X113.php.
11688 - Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. chromé noir

La finition du Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. chromée noire est exceptionnelle et exclusive. Le modèle noir mat est en laiton massif. La design traditionnel s'inspire de son prédécesseur fabriqué en 1959 et reflète ses caractéristiques typiques, telles que les bagues de mise au point et de diaphragme au look rétro. En outre, la conception de l'échelle des pieds est en rouge. Un pare-soleil en métal rond et un bouchon d'objectif en métal sont également inclus dans la livraison.
10933 - Leica M-P type 240 Edition Safari
L'édition limitée LEICA M-P Edition "Safari" est finie en émail vert olive.

Kit composé de l'appareil, d'un objectif Summicron-M 35 mm f/2 Asph. (argent chromé), d'une sangle en cuir et d'un étui pour carte SD.
13061 - Filtre orange E39
En 2015, à l'occasion de la sortie du M Monchrom type 246, Leica a proposé de nouveaux filtres colorés.

Coloris : orange, vert ou jaune
Diamètres : E39 ou E46
13062 - Filtre jaune E39
En 2015, à l'occasion de la sortie du M Monchrom type 246, Leica a proposé de nouveaux filtres colorés.

Coloris : orange, vert ou jaune
Diamètres : E39 ou E46
13063 - Filtre vert E39
En 2015, à l'occasion de la sortie du M Monchrom type 246, Leica a proposé de nouveaux filtres colorés.

Coloris : orange, vert ou jaune
Diamètres : E39 ou E46
13064 - Filtre orange E46
En 2015, à l'occasion de la sortie du M Monchrom type 246, Leica a proposé de nouveaux filtres colorés.

Coloris : orange, vert ou jaune
Diamètres : E39 ou E46
13065 - Filtre jaune E46
En 2015, à l'occasion de la sortie du M Monchrom type 246, Leica a proposé de nouveaux filtres colorés.

Coloris : orange, vert ou jaune
Diamètres : E39 ou E46
13066 - Filtre vert E46
En 2015, à l'occasion de la sortie du M Monchrom type 246, Leica a proposé de nouveaux filtres colorés.

Coloris : orange, vert ou jaune
Diamètres : E39 ou E46
15545 - Embase
CTOOM/15545 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Embase métallique permettant d’associer un boîtier Leica M3 ou M2 à un flash, munie d’un bras métallique orientable à 180°. Peinture noire en finition "craquelée". Commercialisé par Leitz de 1953 à 1964.

Existe en version plastique de couleur crème pour le flash CHICO de même matière :

Photos © Philippe D.
14067 - Déclencheur souple
FONOT/14067 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)
Déclencheur souple comportant une vis de blocage, longueur 25 cm, apparu en 1955.
Convient aux Leica "M", Leicaflex et Leica "R".


Photos © bulb
14200 - Posemètre Leicameter-MC
Deuxième modèle de posemètre photosensible au sélénium, apparu en 1957, se glissant dans la griffe porte-accessoires et s’accouplant au barillet des vitesses d’un boîtier Leica "M" (jusqu’au Leica M4-P), possédant deux échelles de mesures (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique : METRA/14200).
Ci-dessous, un Leica Meter MC avec ses accessoires pour lumière incidente :



Photos © bulb
13081 - Filtre jaune
Filtre jaune très léger (n° 0) vissant, au diamètre 39 mm (monture E39).
(code Leitz à 5 lettres : HOOAR)

Photo © bulb
13101 - Filtre orange
Filtre orange vissant, au diamètre 39 mm (monture E39).
(code Leitz à 5 lettres : HOOGU)

Photo © bulb
14121 - Tête à rotule
Tête à rotule, grand modèle, avec les deux filetages ("pas du Congrès" et "pas Kodak", désignés respectivement par 3/8" et 1/4" d’inch) ; ci-dessous, la tête dévissée montre la réversibilité des filetages.
Clé de serrage en laiton chromé satiné, puis gainée de résine noire.

Photo © a.noctilux
10850 - Leica SL type 601
Produit décrit sur https://www.summilux.net/sl_system/SL601.php.
11176 - Vario-Elmarit-SL 24-90 mm f/2,8-4 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/sl_system/objectifs/VarioElmaritSL24-90.php.
11175 - Apo-Vario-Elmarit-SL 90-280 mm f/2,8-4
Produit décrit sur https://www.summilux.net/sl_system/objectifs/VarioElmaritSL90-280.php.
11180 - Summilux-SL 50 mm f/1,4 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/sl_system/objectifs/SummiluxSL50.php.
16067 - Adaptateur audio pour Leica SL
L'adaptateur audio AA-SCL4 permet un enregistrement audio en stéréo pour les enregistrements vidéo. Lorsqu'il est monté sur la griffe porte-accessoires de l'appareil Leica SL type 601, toutes les connexions nécessaires sont effectuées simultanément.
16070 - Déclencheur souple (télécommande) pour Leica SL
La principale utilisation de ce déclencheur souple RC-SCL4 est d'éliminer tout risque de tremblement de l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur de l'appareil Leica SL type 601.

16072 - Câble HDMI pour Leica SL ou SL2
Grâce à ce câble de type A, une connexion HDMI aux appareils de prise de vue ou de lecture spécifiés de façon appropriée permet de transmettre des données d'image haute définition.
Adapté au Leica SL type 601 ou SL2

16046 - Film de protection d'écran pour Leica SL

Le film apporte une protection efficace contre les rayures et la saleté, susceptibles d'endommager l'écran du Leica SL type 601. De plus, il réduit considérablement la brillance et permet de visualiser les prises de vue avec un contraste et une clarté élevés sans reflets gênants. Le jeu de films de protection d'écran Leica inclut également un film de remplacement, un chiffon de nettoyage optique et un tampon de nettoyage de l'écran.
16064 - Bouchon arrière d'objectif SL

16062 - Batterie pour Leica SL type 601, SL2, SL2-S ou Q2
Batterie lithium-ion rechargeable BP-SCL4

16065 - Chargeur de batterie pour Leica SL type 601, SL2, SL2-S ou Q2
Chargeur de batterie BC-SCL4

16071 - Câble micro b USB 3.0, 3 m
14624 - Flash SF40

13059 - Filtre à densité neutre ND 16x II E82 noir

14455 - Courroie en cuir noir avec patte d'épaule très large
Cette courroie en épais cuir noir assure un confort remarquable, en particulier grâce à sa patte ultra-large qui épouse idéalement la courbure de l’épaule ou du cou.

Proposée en option avec les Leica SL ou Leica M10.
16063 - Poignée multifonctions SL (HG-SCL4)
Une poignée-grip idéale, y compris pour tenir le Leica SL d’une seule main, en cadrage vertical. Elle comprend un déclencheur et un joystick AF secondaires et un logement pour une seconde batterie.

Illustrée avec la dragonne 16004.
16060 - Bouchon de boîtier Leica SL ou SL2

14025 - Bouchon arrière d'objectif T

13031 - Filtre UVA II E39 argent

Filtre UVA II E39 argent

13032 - Filtre UVA II E43 noir

Filtre UVA II E43 noir

13033 - Filtre UVA II E46 noir

Filtre UVA II E46 noir

13034 - Filtre UVA II E46 argent

Filtre UVA II E46 argent

13035 - Filtre UVA II E49 noir

Filtre UVA II E49 noir

13037 - Filtre UVA II E55 noir

Filtre UVA II E55 noir

13038 - Filtre UVA II E55 argent

Filtre UVA II E55 argent

13039 - Filtre UVA II E60 noir

Filtre UVA II E60 noir

13041 - Filtre UVA II E72 noir

Filtre UVA II E72 noir

13042 - Filtre UVA II E82 noir

Filtre UVA II E82 noir

Le filtre UVA II protège efficacement les objectifs de valeur de la poussière, des embruns, et du risque de bris de la lentille frontale.
13054 - Filtre à densité neutre ND 16x II E39 noir

Filtre ND 16x II E39 noir

13055 - Filtre à densité neutre ND 16x II E46 noir

Filtre ND 16x II E46 noir

13056 - Filtre à densité neutre ND 16x II E55 noir

Filtre ND 16x II E55 noir

13057 - Filtre à densité neutre ND 16x II E60 noir

Filtre ND 16x II E60 noir

13050 - Filtre polarisant-circulaire E72 noir

Filtre polarisant-circulaire E72 noir

13052 - Filtre polarisant-circulaire E82 noir

Filtre polarisant-circulaire E82 noir

14406 - Dragonne
Courroie de poignet (dragonne)


Photos © Piga
14522 - Sac en cuir
Sac en cuir nappa M + Elmar-M 50 mm f/2,8
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/accessoires.html.
14022 - Bobine
Bobine réceptrice avec bouton à ressort pour Leica M3, M2, M1, MD, IIIg et Ig.

Photo © bulb
14097 - Bague vis / baïonnette
Bague intermédiaire à baïonnette permettant d’utiliser un objectif à vis de distance focale 50 mm sur un boîtier Leica "M", faisant apparaître dans le viseur le cadre correspondant.
Code Leitz à cinq lettres : IRZOO
La bague située à gauche correspond à 14097 :

Photo © Mahé Charles
14098 - Bague vis / baïonnette
Bague intermédiaire à baïonnette permettant d’utiliser un objectif à vis de distance focale 90 mm
sur un boîtier Leica "M", faisant apparaître dans le viseur le cadre correspondant.
Code Leitz à cinq lettres : ISBOO

Photo © maddav
La bague située au milieu correspond à 14098 :

Photo © Mahé Charles
14099 - Bague vis / baïonnette
Bague intermédiaire à baïonnette permettant d’utiliser un objectif à vis de distance focale 135 mm
sur un boîtier Leica "M", faisant apparaître dans le viseur le cadre correspondant.
Code Leitz à cinq lettres : ISOOZ
La bague située à droite correspond à 14099 :

Photo © Mahé Charles
11086 - Apo-Macro-Elmarit-TL 60 mm f/2,8 Asph. noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Apo-Macro-Elmarit-TL-60-mm-f-2-8-Asph.
11087 - Apo-Macro-Elmarit-TL 60 mm f/2,8 Asph. argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Apo-Macro-Elmarit-TL-60-mm-f-2-8-Asph.
19100 - Leica Sofort blanc

Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Sofort.
19101 - Leica Sofort menthe

Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Sofort.
19102 - Leica Sofort orange

Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Sofort.
19550 - Film Leica Instant Monochrom
Film N&B pour appareil instantané Leica Sofort

Format : Instax-mini
14894 - Etui souple en cuir noir pour Leica M, avant long

Adaptée à un M (y compris le Leica M10) avec un objectif ne dépassant pas 65 mm de diamètre et 80 mm de longueur.
14893 - Etui souple en cuir noir pour Leica M, avant court

Adaptée à un M (y compris le Leica M10) avec un objectif ne dépassant pas 65 mm de diamètre et 60 mm de longueur.
24020 - Protector, demi-étui pour Leica M10, cuir noir

24021 - Protector, demi-étui pour Leica M10, cuir brun

24022 - Protector, demi-étui pour Leica M10, cuir rouge

18764 - Courroie de port en cuir brun
Adaptée par exemple au Leica M10

18577 - Courroie de port en cuir rouge
Adaptée par exemple au Leica M10

18575 - Courroie de port en cuir noir
Adaptée par exemple au Leica M10
24015 - Repose-pouce (Thumb Support) pour Leica M10, argent

24014 - Repose-pouce (Thumb Support) pour Leica M10, noir

24019 - Poignée pour Leica M10, argent

Présentée ici avec une dragonne de doigts.
24018 - Poignée pour Leica M10, noir

Présentée ici avec une dragonne de doigts.
24017 - Film de protection d'écran pour Leica M10

24003 - Batterie pour Leica M10

24002 - Chargeur de batterie pour Leica M10

BC-SCL5
42308 - Adaptateur pour digiscopie

Pour monter une longue-vue APO-Televid sur un Leica M10 ou autre appareil avec fonction Live View.
Extrait du site Leica :
En parfaite adéquation avec les longues-vues Leica, cet objectif 35 mm, qui peut être utilisé sur tous les appareils dotés d’objectifs interchangeables, permet de réaliser des prises de vue d’une qualité impressionnante.
L’objectif Leica pour digiscopie est le complément idéal pour les observateurs de la nature ambitieux qui veulent capturer leurs impressions dans une parfaite qualité d’image. Utilisé avec l’adaptateur Leica TL, cet objectif est compatible avec chaque appareil de système qui dispose d’un viseur électronique ou de la fonction Live View. L’adaptateur Leica TL a été optimisé pour les appareils à capteur APSC. Il peut cependant être également utilisé pour des appareils dotés d’un capteur plus petit ou plus grand.
24001 - Adaptateur pour monter des correcteurs dioptriques sur un Leica M10

24008 - Lentille correctrice pour Leica M10, +3 dpt

Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14354. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
20001 - Leica M10 chromé argent

Leica M10 type 3656
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M10.
24004 - Lentille correctrice pour Leica M10, +0,5 dpt
Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14350. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
24005 - Lentille correctrice pour Leica M10, +1 dpt
Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14351. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
24006 - Lentille correctrice pour Leica M10, +1,5 dpt
Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14352. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
24007 - Lentille correctrice pour Leica M10, +2 dpt
Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14353. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
24009 - Lentille correctrice pour Leica M10, -0,5 dpt
Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14355. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
24010 - Lentille correctrice pour Leica M10, -1 dpt
Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14356. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
24011 - Lentille correctrice pour Leica M10, -1,5 dpt
Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14357. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
24012 - Lentille correctrice pour Leica M10, -2 dpt
Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14358. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
24013 - Lentille correctrice pour Leica M10, -3 dpt
Cette lentille est adaptée au Leica M10, pour les autres Leica M, l'équivalent et la lentille 14359. Cette dernière référence peut toutefois être montée sur le Leica M10 en utilisant l'adaptateur 24001.
42333 - Adaptateur digiscopique pour Leica X type 113

Le raccordement d'un Leica X (Type 113) avec son adaptateur digiscopique dédié, sur les oculaires et longues vues Leica APO-Televid 82 ou Leica APO-Televid 65, vous permet de bénéficier d'une focale allant de 850 mm à 3.100 mm. Le couple longue-vue compact numérique X à capteur haute performance, offre une manipulation sûre, une grande polyvalence ainsi qu'une bonne stabilité. Grâce à son grand capteur APS-C et son objectif lumineux (f:1,7), vous obtenez des images encore plus riches en contraste, en luminosité et en profondeur. Même si les conditions météorologiques et de luminosité sont mauvaises et que vous travaillez en ISO élevé! Egalement nouveau, la fonction vidéo du Leica X (Type 113), qui vous offre la possibilité de filmer en digiscopie au MP4-Format.
18187 - Leica TL2 type 5370 noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-TL2-type-5370.
18188 - Leica TL2 type 5370 argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-TL2-type-5370.
11697 - Thambar-M 90 mm f/2,2, finition peinture noire
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Thambar-M-90-mm-f-2-2.
11179 - Apo-Summicron-SL 90 mm f/2 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Apo-Summicron-SL-90-mm-f-2-Asph.
12302 - Pare-soleil pour Apo-Summicron-SL 50, 75 ou 90 mm f/2 Asph.

13071 - Filtre à densité neutre ND 16x II E67 noir

13040 - Filtre UVa II E67 noir

16045 - Bouchon avant d'objectif SL E67

11672 - Summicron-M 28 mm f/2 Asph. noir
Version légèrement modifiée du modèle 11604 (qu'il a remplacé en 2016).
11673 - Summicron-M 35 mm f/2 Asph. noir
Version de cet objectif sortie en 2016 (évolution du modèle 11879).
11674 - Summicron-M 35 mm f/2 Asph. chromé
Version de cet objectif sortie en 2016 (évolution du modèle 11882).
11677 - Elmarit-M 28 mm f/2,8 Asph. noir
Version sortie en 2016 de la référence 11606.
12301 - Pare-soleil pour Vario-Elmarit-SL 24-90 mm f/2,8-4 Asph.

12300 - Pare-soleil pour Apo-Vario-Elmarit-SL 90–280 mm f/2,8–4

12303 - Pare-soleil pour Summilux-SL 50 mm f/1,4 Asph.

14625 - Flash SF 60

14620 - Flash SF 64

16041 - Bloc secteur S type 007

16042 - Adaptateur audio pour S type 007

16040 - Câble USB 3.0 pour S type 007

16039 - Batterie pour S2, S type 006 ou S type 007

20021 - Leica M10-P noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M10-P.
20022 - Leica M10-P chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M10-P.
20014 - Leica M10-D
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M10-D.
14652 - Macro-Adapter-M
Accessoire pour le Leica Macro-Elmar-M 90 mm f/4.

Cet adaptateur est fait pour la photographie rapprochée. Il augmente le tirage et permet une distance de mise au point comprise entre 0,77 et 0,55 m avec un rapport de 1:3. Il se monte sur la baïonnette du boîtier, exactement comme avec un objectif. Sa conception garantit une correction automatique de la parallaxe et une position correcte du cadre du viseur.

Il peut être utilisé avec d'autres objectifs (focale supérieure à 28 mm)
Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/MacroElmarM90-2014.html.
18544 - Batterie BP-DC15-E pour Leica D-Lux type 109, D-Lux 7 ou C-Lux
10981 - Leica M-E type 240
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-ME-240.
11185 - Apo-Summicron-SL 50 mm f/2 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Apo-Summicron-SL-50-mm-f-2-Asph.
11678 - Summilux-M 90 mm f/1,5 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Summilux-M-90-mm-f-1-5-Asph.
20050 - Leica M10 Monochrom
Produit décrit sur http://summilux.net/materiel/Leica-M10-Monochrom.
10475 - Leica M6 TTL 0,58 noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M6-TTL.
10474 - Leica M6 TTL 0,58 chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M6-TTL.
10466 - Leica M6 TTL 0,85 chromé argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M6-TTL.
10542 - Leica M6 TTL 0,58 « Last 999 Edition » chromé noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M6-TTL.
10545 - Leica M6 TTL 0,58 « Last 999 Edition » chromé argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M6-TTL.
10543 - Leica M6 TTL 0,58 « Last 999 Edition » chromé argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M6-TTL.
10544 - Leica M6 TTL 0,85 « Last 999 Edition » chromé noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M6-TTL.
20002 - Leica M10-R noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M10-R.
20003 - Leica M10-R argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M10-R.
20061 - Leica M10 Monochrom, édition Leitz Wetzlar
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M10-Monochrom.
19626 - Sac Ettas rouge

Un sac adapté aux Leica V-Lux, Q, ou M avec une optique de moins de 90 mm.
19627 - Sac Ettas khaki

Un sac adapté aux Leica V-Lux, Q, ou M avec une optique de moins de 90 mm.
14006 - Chargeur de film
Chargeur de film, dit aussi "modèle N", destiné à tout modèle de Leica (à vis et "M" jusqu'au M6 mais pas au M5),
ouvert et fermé par la clé de la semelle. Référence (code Leitz à 5 lettres) : IXMOO.

Photo © macinside
A gauche : emballage cartonné.
Au centre : la boîte (référence n° 14010).
A droite : les deux parties coulissantes du chargeur.
En bas : la bobine (référence n° 14015).
12002 - Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 21 mm
(code Leitz à 5 lettres : SBKOO)
Ci-dessous la dernière version de ce viseur, en finition noire avec son étui en cuir :


Photos © rodolph M
16066 - Télécommande RC-SCL6 pour Leica SL2

16460 - Loupe de visée pour Visoflex II
Loupe de visée pour chambre reflex Visoflex II procurant une image redressée.
L’oculaire possède une monture hélicoïdale permettant de l’adapter à sa vue (grandissement 4x).
(équivalent dans le code Leitz à 5 lettres : OTXBO)


Photos © pepe4243
16598 - Bague intermédiaire
Bague permettant le montage des têtes des objectifs suivants sur le dispositif à soufflet :
Summicron f:2/90 mm (mise au point entre les rapports 1:25 et 1:1)
Elmarit f:2,8/135 mm (mise au point entre les rapports 1:17 et 1:1,25)
Telyt f:4/200 mm (mise au point de l’infini jusqu’au rapport 1:3)
Telyt f:4,8/280 mm (mise au point de l’infini jusqu’au rapport 1:6)
Code Leitz à cinq lettres : UOOZK
11686 - Noctilux-M 50 mm f/1,2 Asph. noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Noctilux-50-f1-2-Asph.
11702 - Noctilux 50 mm f/1,2 Asph. chromé
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Noctilux-50-f1-2-Asph.
12522 - Pare-soleil
Pare-soleil spécifique de la première version du Summilux f:1,4/35 mm (apparue en 1961),
jusqu'au numéro 2166700, dont le diamètre externe de la couronne antérieure est de 46,5 mm.
(code Leitz à 5 lettres : OLLUX)
11189 - Vario-Elmarit-SL 24-70 mm f/2,8 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Vario-Elmarit-SL-24-70-mm-f-2-8-Asph.
20062 - Leica M10-R laqué noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M10-R.
19060 - Leica Q2 007 Edition
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Q2.
12481 - Container pour objectif Leica M

Cette boîte est adaptée aux objectifs à monture M d'une hauteur maximale approximative de 80 mm (sans la baïonnette) et d'une largeur maximale de 68 mm.

10372 - Leica M-A Titane et Apo-Summicron-M 50 mm f/2 Asph. Titane
Édition spéciale (2022, 250 exemplaires).
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-M-A.
19069 - Q2 Dawn by Seal
Edition limitée à 500 exemplaires
- Leica Q2 habillé d'un tissu japonais Komorebi composé de fil noir et de papier doré
- Désigné par Seal, auteur, chanteur et photographe, lauréat d'un Grammy Award.
- Foulard de collection conçue par l'artiste Annina Roescheisen, imprimé des paroles de chansons de Seal.
- Courroie embossée avec une parole manuscrite par Seal, extraite d'une chanson.
- Signature de Seal et numéro d'édition de 001 à 500 gravés sur l'écran arrière.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Q2.
19054 - Leica Q2 Ghost by Hodinkee
Le Leica Q2 "Ghost" by Hodinkee est une édition spéciale exclusive du Q2 créée en collaboration avec Hodinkee, site internet de vente de montres. Son design intemporel rend hommage à une montre de plongée iconique connue des initiés sous le nom de "lunette fantôme".
12/2022
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Q2.
11193 - Summicron-SL 50 mm f/2 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Summicron-SL-50.
19185 - Leica D-Lux 7 Edition 007
No Time to Die (2021) a marqué la vingt-cinquième aventure cinématographique de James Bond, ainsi que la cinquième et dernière prestation de Daniel Craig dans le rôle de 007. L'agent secret britannique a conquis le public depuis que Sean Connery a fait ses débuts dans le rôle de James Bond dans Dr. No (1962).
Raffiné, discret, toujours prêt pour l'action : ces signes caractéristiques de James Bond s'appliquent également au Leica D-Lux 7. L'édition spéciale limitée (2023) se distingue par un design particulièrement élégant et une gamme d'accessoires exclusifs.
Outre l'élégant habillage de l'appareil photo - réalisé dans un matériau haute qualité au subtil dessin en forme de losange - et la gravure 007 sur le capot supérieur, l'édition 007 se distingue par un étui d'épaule. L'étui en cuir permet de transporter l'appareil photo en toute sécurité tout en restant à portée de main à tout moment. La poignée (assortie à l'habillage de l'appareil) et la dragonne garantissent une maniabilité sûre dans les situations nécessitant d'être rapide, tandis que le bouchon d'objectif au design classique en forme de canon s'ouvre automatiquement dès que l'appareil est allumé.
Cette édition du D-Lux 7 007 comprend un étui pour l'appareil photo, une poignée et une dragonne, ainsi qu'un bouchon automatique d'objectif. L'édition spéciale sera disponible à 1 962 exemplaires seulement dans le monde entier.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-D-Lux-7.
19167 - Leica D-Lux 7 “A BATHING APE® х STASH”
L'édition spéciale du Leica D-Lux 7 "A BATHING APE® x STASH" incarne tout ce touche à la vibration urbaine. L'appareil photo compact porte la signature du graffeur new-yorkais STASH - également connu sous le nom de Josh Franklin - et de la marque de streetwear A BATHING APE® (BAPE®). Ainsi, l'appareil photo ne se contente pas de capturer l’atmosphère de la vie urbaine, il arbore le look camouflage caractéristique de la marque de streetwear et son signe reconnaissable dans le monde entier, la tête de singe.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-D-Lux-7.
11191 - Vario-Elmar-SL 100-400 mm f/5-6,3
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Vario-Elmar-SL-100-400.
19092 - Leica Q2 100 ans Disney
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Q2.
11729 - Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. (II) chromé argent
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Summilux-M-50-mm-f-1-4-Asph-II.
11728 - Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. (II) anodisé noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Summilux-M-50-mm-f-1-4-Asph-II.
19082 - Leica Q3 type 6506
Modèle pour les pays hors Europe, Etats-Unis, Chine, Japon.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Q3.
19081 - Leica Q3 type 6506
Modèle pour le Japon
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Q3.
19080 - Leica Q3 type 6506
Modèle pour l'Europe, les Etats-Unis ou la Chine.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Q3.
19190 - Leica Sofort 2 noir

Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Sofort-2.
19660 - Capuchon d'objectif Q, E49, aluminium argenté

19623 - Film de protection d'écran arrière pour M10, SL, Q2, Q3
Pour Leica M10 / M10-P / M10-R, SL, Q2, Q3

16061 - Poignée multifonctions HG-SCL6
Compatible Leica SL2 et SL2-S

12306 - Pare-soleil pour Apo-Summicron-SL 35mm f/2 Asph.

12304 - Pare-soleil pour Super-Vario-Elmar-SL 16-35 mm f/3,5-4,5 Asph.

16057 - Pare-soleil pour Vario-Elmar-SL 100-400mm

12309 - Pare-soleil pour Vario-Elmarit-SL 24-70 mm f/2,8 Asph.

16059 - Chargeur double USB-C BC-SCL6 (Leica Q3, Q2, SL2, SL2-S, SL3, SL3-S)

Avec le chargeur double USB-C Leica, vous pouvez charger simultanément deux batteries BP-SCL6 ou BP-SCL4. Chaque emplacement comporte trois LED d'état, qui affichent l'état de charge de chaque batterie, ce qui permet de vérifier facilement que vos batteries sont prêtes et entièrement chargées à tout moment.
16200 - Coupleur USB-CDC-SCL6

Le coupleur DC est un accessoire essentiel pour les photographes et les cinéastes qui ont besoin d'une alimentation constante pour leur appareil photo. Cette batterie factice remplace la batterie standard de l'appareil photo, permettant un fonctionnement continu de l'appareil. Avec son port USB-C intégré, le DC-Coupler constitue une solution polyvalente pour alimenter votre appareil photo. Idéal pour les longues séances de photo ou d'enregistrement vidéo, où une alimentation ininterrompue est cruciale, vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre sujet sans vous soucier de l'autonomie de la batterie.
18867 - Kit d'alimentation SL3, SL3-S

Kit d'alimentation USB-C.
Entrée : 110 -240 V 50 /60 Hz 0,70 A
Sortie : 5.0 V 3.0 A 15.0 W / 9.0 V 3.0 A 27.0 W
16201 - Adaptateur secteur USB-C ACA-SCL6

L'adaptateur secteur Leica est compatible dans le monde entier, grâce à ses types de prises polyvalents, facilitant une charge rapide et sécurisée de la batterie. De plus, lorsqu'il est utilisé avec un câble USB-C vers USB-C, le bloc d'alimentation compact permet de charger directement la batterie à l'intérieur de l'appareil photo. L'adaptateur secteur est également compatible avec de nombreux appareils grâce à sa sortie USB-C.
Entrée :
110 -240 V 50 /60 Hz 0,70 A
Sortie :
5,0 V 3,0 A 15,0 W
9,0 V 3,0 A 27,0 W
18828 - Câble USB-C vers USB-C

Le câble USB-C durable permet un transfert de données rapide et sécurisé, facilitant le chargement pratique de la batterie de l'appareil photo directement dans l'appareil photo lorsqu'il est utilisé avec l'adaptateur secteur Leica 16201.
Longueur : 1 m
16058 - Poignée Multifonction HG-SCL7 pour SL3 ou SL3-S

La poignée multifonction garantit une manipulation optimale pour la photographie et la prise de vue en mode portrait ou paysage. Spécialement conçue pour le Leica SL3, elle présente un design assorti et une fonctionnalité inégalée. Elle est dotée d'un bouton d'obturateur supplémentaire, d'un filetage pour trépied, d'un joystick, de deux molettes dont une frontale. Elle comporte également un emplacement pour une batterie supplémentaire (BP-SCL6 ou BP-SCL4), ce qui permet de doubler l'autonomie.
Pour plus de stabilité, une dragonne assortie (18557) est disponible.

24035 - Courroie en cuir noir

24036 - Courroie en cuir cognac

24037 - Courroie en cuir vert olive

24032 - Demi-étui en cuir noir pour Leica M11

24033 - Demi-étui en cuir cognac pour Leica M11

24034 - Demi-étui en cuir vert olive pour Leica M11

24023 - Courroie pour Leica M, cuir noir

18500 - Courroie de port en cuir jaune, pour Leica M, Q et X

11096 - Vario-Elmarit-SL 70-200 mm f/2,8 Asph.
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Leica-Vario-Elmarit-SL-70-200-mm-f-2-8-Asph.
97097 - Livre Leica M (2024) en langue anglaise
Produit décrit sur https://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=109758.
97096 - Livre Leica M (2024) en langue allemande
Produit décrit sur https://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=109758.
11731 - Noctilux-M 50 mm f/1,2 Asph. laqué noir
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Noctilux-50-f1-2-Asph.
11714 - Summilux-M 50 mm f/1,4 Classic
Produit décrit sur https://www.summilux.net/materiel/Summilux-M-50-mm-f-1-4-Classic.











